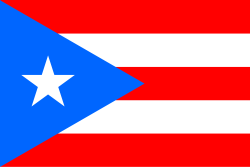0
Members
0
Views
0
Reactions
0
Stories read
Need to take a break?
For immediate help, visit {{resource}}
Made with in Raleigh, NC
Read our Community Guidelines, Privacy Policy, and Terms
Have feedback? Send it to us
Survivor story
Une famille comme les autres (ou presque)
Original story
UNE FAMILLE COMME LES AUTRES (OU PRESQUE) Séléna Ceci est un témoignage sous la forme du récit d’une partie de ma vie. Après une enfance plutôt heureuse, j’ai été persécutée pendant toute mon adolescence. C’est à douze ans que j’ai dû me confronter à la folie d’un père avec qui je n’avais pas encore vécu. Cette période de ma vie n'a donc pas été peuplée de rêves d’avenir, ou de craintes de grandir, mais de celles de vivre au jour le jour, et d'élaborer des stratégies d’évitement, voire d’élimination de ce bourreau auquel il fallait absolument échapper. Mon adolescence est une plaie que je dois soigner par l'expression de ce que j'ai vécu. Cette expression est aussi un pied de nez au tabou, au secret de famille, à la « cellule » familiale, à l’abus d’autorité parentale, de pouvoir, à la violence en général, et à celle faite aux femmes en particulier. Elle m’aide à soigner les effets de la peur et la honte qui se sont infiltrées dans ma construction comme des cancers, et ne peut plus se limiter au cercle de mes proches. L’ombre du secret que je ne veux plus garder a diminué mais persiste. J’ai besoin d’avancer pour la réduire encore. Je ne veux plus de ce secret empoisonné, ni être tiraillée entre le besoin d’être (re)connue et la peur de l’être. La liste des victimes qui m’ont précédée et qui me succéderont est longue. Ces dernières n’ont souvent pas d’autres alternatives qu’un douloureux repli sur soi pouvant aller jusqu’à la folie, ou la répétition de la violence subie, qui est aussi une folie. Mon environnement, après avoir été toxique, s’est heureusement modifié. Mon parcours et mes rencontres m’ont alors permis de sortir peu à peu de cette spirale encore trop souvent présentée comme une fatalité. Plus que d’une personne en particulier, c’est de cette spirale et de sa représentation dont je suis victime. Et ce même si j’ai choisi d’articuler mon récit en faisant quelques portraits à charge des personnes, à l’avantage de la victime que je suis, et à qui il faut bien reconnaître ce statut, sans pour autant l’y réduire. Ces personnes étaient elles aussi des pions, et des victimes d’un système familial. Système que je décide de bousculer aujourd’hui. Je pense avoir un devoir envers les victimes et témoins de situations analogues qui, peut être, me liront, et s’autoriseront à parler. J’aimerais me rendre une part de la justice qui m'a été refusée. Je dédie ce livre à mes trois filles et à leur père, mon compagnon. J’aimerais qu’il aide mes petits enfants à comprendre ce qu’il s’est passé sans avoir honte de leur généalogie. C’est la violence qu’il faut combattre, et éviter de focaliser sur un coupable, même si ce dernier aurait mérité d’être condamné, y compris pour lui-même. Cette focalisation nous dédouane, tout en nous inoculant la peur de devenir un jour coupable de violence, dans une pensée binaire et judéo-chrétienne. Ce n’est certainement pas le meilleur moyen pour ne pas devenir soi-même auteur. La violence est en chacun de nous, inhérente au fait que nous soyons des êtres sociaux, à la fois en bonheur et en malheur de l’être. Combattons-la par l’expression, la prévention, l’éducation, et les soins. Nous ne sommes dotés de cette violence que pour nous défendre lorsque notre intégrité et celle de ceux que nous devons protéger est en danger. Tout le reste n’est que déviance. La descente aux enfers Je n'ai réellement connu mon père qu'à l'âge de 12 ans. Jusqu'à cet âge, je ne l'avais vu qu'une à deux fois par an, et nous ne connaissions sa maison que pour y avoir passé deux fois de courtes vacances. Toute notre enfance était déjà dans un camion en partance pour cette maison, à environ quatre cents kilomètres de l’endroit où nous avions grandi. Nous avions fait escale pour notre dernière nuit chez notre grand-mère, sa mère, avant notre départ pour l'enfer. Ce soir-là, il m’appela, alors qu'il était en slip, en train de se déshabiller pour la nuit. Il s’adressa à moi d'un ton autoritaire : " Si tu veux me voir nu, il faut le demander! ". Je restai un instant interdite, me tournant vers ma mère pour chercher de l’aide. Je revois l’expression de celle-ci, s'offusquant maladroitement. Je compris déjà, sans en avoir encore réellement conscience, l’impuissance, et la peur qu'elle avait toujours eues de cet homme lorsqu'il la repoussa violemment. Je partis me réfugier dans mon lit. Dès ce moment en fait, j’ai vu mon père tel qu'il était : un monstre qui ne s'intéressait qu'aux virginités de ses filles. C’était un psychotique qui avait d’ores et déjà élaboré un plan dont il voulait soigner la préparation. Son comportement vis-à-vis de nous avant que nous soyons «prêtes», comme il le disait, se fondait sur la peur qu’il ne soit pas le premier. Dans sa folie, c’était la condition sans laquelle nous ne lui appartiendrions jamais. Il était persuadé d’arriver ainsi à nous séduire. Il pensait aussi que, pour ne pas rater cette place de premier, il devait être aux aguets du moment « propice », ce qui supposait pour lui de se comporter en despote avec nous. Ce qui supposait aussi, dans ses moments plus calmes, de faire notre éducation sexuelle en nous proposant de se montrer nu, par exemple, et en le faisant aussi quelquefois sans nous le proposer. Il était du genre à revendiquer le rétablissement du droit de cuissage ou celui d'aînesse (il était l'aîné de sa famille). Il se vantera aussi d'origines soi-disant nobles. Cela servira manifestement à légitimer la position despotique qui convenait parfaitement à sa psychose. C'est aussi ce soir de déménagement que je sentis sans le comprendre encore vraiment que les démonstrations d'indépendance dont ma mère avait fait preuve jusque-là n'étaient qu'un leurre et qu’elle n’avait été que dans une forme de liberté surveillée. Le temps de la séquestration avait commencé. Un seul bonheur : le boulot de chauffeur-livreur de ce père qu'on nous imposait l'obligera à quitter sa maison du lundi au vendredi sans interruption, et il travaillait sur Paris, à deux cents kilomètres. Bonheur non sans nuage tout de même : nous devions pouvoir lui parler au téléphone aux heures où nous étions censées être là, et il appelait dès qu'il s'arrêtait dans son hôtel du soir. Ma sœur et moi avons des voix très similaires, un soir j'aurais réussi à l'imiter. Le fait de ne pas être là nous coûtait toujours cher. De toute façon il arrivait toujours à nous empoisonner, même quand il n'était pas là. Il était difficile de ne pas penser à lui. Il y eut donc beaucoup de violences, de harcèlement, de séquestrations, d’humiliations, de peurs, de dégoûts, de tristesse, de honte, jusqu’à ce 4 mai 1979. L'ironie du sort voulut que ce soit la veille de mes dix sept ans. Mais je m’en foutais. Je n’ai d’ailleurs gardé aucune symbolique néfaste entre mon anniversaire et l’événement. Heureusement pour moi, j’avais déjà vécu d’autres anniversaires joyeux dans mon enfance. Même si je gardais encore l'infime espoir qu'un événement inattendu puisse empêcher les choses, je savais bien que j'étais prise au piège, et que tout ce que je pouvais encore préserver était ma vie. La peur m'avait envahie, ma tête était remplie de haine. Son harcèlement avait été plus intense, et plus triomphant toute la soirée, où, pour la première fois, nous nous retrouvions seuls, chez lui, entourés de voisins qui lui accordaient toute leur confiance. Ma sœur, de dix huit mois plus âgée, s'était enfuie le jour de sa majorité, et ma mère était hospitalisée. Je ne craignais pas les coups que j'allais recevoir en lui résistant, et il le savait. Mais je connaissais sa violence et sa folie, et me méfiais des proportions qu'elle pouvait prendre dans de telles circonstances. Il était fou, et mon insoumission pouvait m'être fatale, même s’il ne le voulait pas. Il nous menaçait souvent de décrocher « le » fusil dans ses excès de rage. Le dit fusil était accroché au mur, comme chez les chasseurs (qu’il était quelquefois), comme une menace. Je voulais juste ne pas mourir, je voulais vivre après lui, vivre après mes dix huit ans, vivre comme tout le monde. M'enfuir? Il avait bien sûr pris soin de fermer la maison, portes et volets, ce qui n’était pas forcément dans ses habitudes. Il l'avait plus fait pour que personne ne puisse entrer, car il savait que pour ma part, je ne pouvais de toute façon pas aller bien loin, dans cette maudite campagne. Encore fallait-il que je trouve quelqu'un qui veuille bien croire à mon histoire. Il bénéficiait de l’admiration de tous dans ce village où il s’était construit l’image de marque du parisien plein aux as avec lequel il vaut mieux être en bons termes. Il s'était notamment fait pour amis les membres d'une famille de cinq enfants, dont quatre filles, dans nos âges. A notre arrivée, il entretenait encore un comportement obscène avec la mère, et buvait avec le père. Quant aux filles, j'eus un jour l'occasion de parler de lui avec l'une d'elles. Nous étions au collège toutes les deux, et c'est sur le chemin pour s’y rendre qu'elle avait elle-même entamé la discussion. Elle me dit clairement qu'elle avait remarqué le comportement douteux de notre père avec nous, et qu'il lui était arrivé d'avoir le même avec ses sœurs et elle. Mon père n'était alors plus aussi séduisant qu'avant, et il manquait de conquêtes. Il ne voulait pas pour autant se soumettre à être moins exigeant. Les adolescentes « prêtes », et encore vierges, encore une fois, lui sont apparues comme des proies plus faciles, dans la mesure où il pouvait user de son autorité, et les « initier ». L'autorité avait ses limites envers les enfants d'une autre personne, et il s'est alors rappelé qu'il avait des filles qui grandissaient. Des filles sur lesquelles il avait tous les droits et tous les pouvoirs, selon des lois ancestrales que son cerveau malade pouvaient mettre au goût du jour. Il n’avait pas besoin de faire beaucoup d’efforts pour ça. Lors de notre discussion, je n’avais pas pu nier l'évidence et je me rappelle de l'étonnement qu'elle avait eu du fait que ma mère l'avait tout de même rejoint. A partir de là, je n'avais eu d'autre préoccupation que de défendre cette dernière, et par conséquent de minimiser la situation. J'avais eu peur de la salir, j'avais toujours été si fière d'elle. Faire passer mon héroïne pour une petite chose faible et peureuse, dont je n'étais pourtant même pas sûre d'avoir le soutien si je glissais dans l'accusation, avait été trop difficile. Elle nous conseillait le silence en nous promettant le bonheur « d'après nos dix huit ans ». C'est pendant cette période pourtant que nous aurions vraiment eu besoin des autres. Ces autres dont j'aurais aimé qu'ils comprennent en dépit de ma mère, du tabou, de la peur. Certains peut-être reconnaîtront le contexte, celui-là, ou d'autres similaires. Il ne faut jamais sous-estimer un geste, ou une parole douteuse. Si quelqu'un était venu me voir franchement pour me proposer sa protection, je n'aurais pas nié. Mais il aurait fallu beaucoup de courage, un grand sens de l’observation, et de la communication. Des qualités qui ne sont pas encore assez développées à mon sens, même dans les formations de travailleurs sociaux, pour ces crimes précis. Tout ce qui aurait pu nous soustraire au despotisme de notre père aurait été le bienvenu. Cette invisibilité était destructrice elle aussi. J’ai bien conscience cependant que le contexte de l’époque, les droits de l'enfant, la reconnaissance de l'inceste, n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, autant dire même qu’ils n’étaient rien du tout, même s'il reste encore beaucoup à faire. Je ne voyais pas très bien non plus où nous pourrions aller pour qu’il ne nous retrouve pas. Et notre mère nous disait que c’était impossible. J’en arrivais toujours à la triste conclusion qu’il fallait patienter et me protéger jusqu’à mes dix huit ans, ou le tuer. Je m’endormais en espérant sa mort. Je me souviens tout de même de l'échange avec cette copine comme d'un événement singulier. Quelqu'un, enfin, osait me parler de lui sans retenue. Comme une petite porte ouverte sur la liberté qui laissait entrevoir des possibles. Avant ce quatre mai, il nous avait déjà obligées à dormir ensemble dans les hôtels des tournées auxquelles il avait tenu à nous emmener pendant les vacances scolaires, ma sœur et moi, séparément, bien sûr. Toujours d'une lubricité écœurante, il demandait à ce que nos corps se touchent. Face à mon refus, il avait toujours réussi à se calmer, parce qu'il n’était pas en terrain conquis et que je le menaçais de crier, mais aussi parce que je n’étais pas «prête». Il écumait donc de satisfaction, ce vendredi quatre mai était son jour de chance, il était persuadé que je succomberais à ses charmes dès l'accomplissement de son crime. C'était logique, il n'y avait aucun doute : ça allait marcher. Avec moi, il s'y prenait suffisamment tôt pour que je sois vierge. C'était selon lui ce qu'il avait loupé avec ma sœur, et ce pourquoi elle était partie. Sur le fait que je sois vierge, il avait raison. Le désir que j'avais jusque-là ressenti pour certains garçons n'avait pas trouvé de réciprocité. J'étais une jeune fille qui faisait moins que mon âge. J’avais juste eu quelques flirts, plus jeune. A ce moment là j'avais juste des amis. Je me caressais parfois en pensant à certains, c'était là le seul plaisir de ma vie d'adolescente. J'avais peur aussi qu'il tue ce désir qui constituait mon seul refuge d'intimité, de féminité, d'indépendance. Aussi incroyable que cela puisse paraître que j’en éprouve, c’est comme ça que je le vivais. Comment ne pas l'énerver ? : lui faire comprendre qu'il ne pourrait jamais me rendre amoureuse de lui? C'était démonter un échafaudage qu'il avait construit depuis des années… Et il était déterminé, il ne voulait pas rater une si belle occasion. Même s’il était sûr à l’époque que ma mère allait mourir de son cancer, ce qu’il ne cessait de me répéter, il était incapable de savoir si cela prendrait plus ou moins d’un an, et si je resterais aussi « pure » que je l’étais. Son plan démoniaque était celui-là : ma mère allait mourir, et il envisageait que je la remplace. Mais il fallait me conquérir avant que je n’aie le droit légal de partir. Ce soir-là, j'étais donc pétrifiée dans mon lit, espérant encore son découragement, infime espoir avant l’exécution. L'acte par lequel il était persuadé de voler mon corps et ma conscience se fit donc. Sur les faits il avait raison, pas sur leurs conséquences. Il s'imposa dans mon lit. Il était d'abord calme, et m'écoutait, alors que j’essayais péniblement de trouver des arguments et d'adopter une conduite dissuasive. Ayant préféré que je sois consentante, il fit preuve d'une patience qui ne lui était pas habituelle, mais toute relative quand même. Il finit ensuite par s'énerver franchement. Je lui hurlai en retour toute la haine que j'avais accumulée pendant cinq ans, tout en le ruant de coups de pied trop faciles à maîtriser. Cela dura assez longtemps pour que je me décourage et que mes forces me lâchent. Avant de capituler, je lui fis promettre de ne pas dormir avec moi après. Même si sa promesse ne valait pas grand chose, je n'avais plus que ça. Il se débarrassa alors de ce qui le gênait pour poser ses yeux sadiques sur ce que j’avais de plus intime. Le viol commence par ce regard. Le noir, la solitude, les sorcières, les chagrins ordinaires, les rêves de première fois ne signifient plus rien. Plus rien n’a de sens, mon père va me violer. Malgré ma paralysie, je crois que s'il avait mis sa tête entre mes jambes, je l’aurais défoncée à coups de pied. Il ne le fit pas, pas plus qu’aucune autre tentative de caresse que je redoutais aussi. Et là, dans la précipitation, il mit un préservatif. Ce fût mon seul réconfort. Ce bout de plastique, qui évita un contact avec mon intimité, me fut d'un grand secours pendant des années. Même s'il aura contribué peut-être à ce que j'en arrive à minimiser ce qui s'était passé. La présence de ce préservatif était aussi l'effet d'un de mes derniers actes d'indépendance : je prenais la pilule (pour faire comme les copines et «au cas où»), et il ne le savait évidemment pas. S'il l'avait su, il n'aurait pas utilisé de contraceptif et l'acte n'en aurait été que plus violent. Peut-être aussi que ce seuil ultime de violence m’aurait poussée à me débarrasser de mon secret plus vite…? Difficile de savoir… Je crois m’être « dissociée » avant « l’acte ». Mon seul refuge ne fut plus que mon espace intérieur barricadé dans la haine, dont je ne soupçonnais pas encore la profondeur, et dans lequel je n’avais plus de corps. L’angoisse est extrême lorsque l’on ne peut plus ni fuir, ni lutter. Si l’on n’en meurt pas, on ne peut en sortir indemne. Monsieur fit donc « sa petite affaire», et s'agita sur moi, attendant un soupçon de plaisir de ma part, avant de me libérer. La précipitation que je ne réalisais alors pas me fit penser bien plus tard qu'il était un éjaculateur précoce. Pour le moment je voulais juste qu’il parte. Il tint sa promesse et quitta mon lit en maugréant que je devais être frigide, ou que je n'étais peut-être pas aussi vierge qu'il l'avait cru. Je n'avais pas saigné, je n'avais ressenti aucune douleur physique. J'étais juste anéantie. Anéantie de dégoût, de haine, de honte. J’allai me laver, et me recouchai, avec un boulet dans la poitrine, et dans l’impossibilité de verser des larmes. Je me réfugiais souvent dans le sommeil. C'était mon seul havre de paix, dont il arrivait à me priver aussi. Il ne supportait pas que l’on reste au lit plus tard que lui. Je faisais des rêves dans lesquels mon père mourait et où nous menions enfin une vie tranquille. Mais là j'étais réellement dans un cauchemar : le week-end ne faisait que commencer. Au matin toujours la même chambre tapissée de l'affreux papier que mes parents m'avaient imposé sous prétexte que je n'arrivais pas à me décider. Toujours cette maison du malheur, du secret, de la honte. Ma mère, à laquelle je ne pouvais pas raconter ça puisqu’elle était considérée entre la vie et la mort, était dans l'impossibilité de me protéger, ne serait-ce que par sa seule présence. Pour ce qui est du coupable, je n'espérais que sa mort, et ce n’était pas pour aujourd’hui encore. J'avais déjà très naïvement tenté de l'assassiner en mettant les calmants que ma mère prenait (ainsi que moi déjà) dans sa soupe. Un soir j'en avais mis une plus grosse quantité. Il avait déambulé comme un zombie toute la soirée. Le lendemain, j'eus trop de chagrin de l'entendre encore se réveiller. Comme il ne se souvenait plus de rien, il fit venir le médecin. Rien ne fut diagnostiqué, et il n'eut pas de soupçon sur ce que j'aurais pu faire. Il ne s'imaginait pas que je puisse souhaiter sa mort. Il y eut donc une autre fois. Je n’y vis de différent que le fait que j’en prévoyais le déroulement. Et tout fut exactement identique. Je m’accrochais fermement aux souhait que ma mère ne soit plus jamais hospitalisée le week-end, et qu’elle vive au moins jusqu’à mes dix-huit ans. Pour qu'il n'y ait jamais d'autres occasions. Il était encore plus insatisfait que la veille. Je m'étonnais déjà d'avoir survécu. Ce n’était pas une blessure visible de mon corps, de mon ventre, ni même de mon sexe. Juste une fracture de la structure même de la personne en devenir que j'étais. Une faille qui s'étend à l'intérieur, et perturbe la capacité à vivre avec les autres. Quand j’ai commencé à ne plus avoir peur, j’ai su que c’était dans la restauration de cette capacité que je pouvais me retrouver. Les murs du silence J'aurais vécu ces premières semaines après les viols dans une hébétude complète. Je me sentais fichue, plus de souvenirs, -ceux de mon enfance me rendaient trop mélancolique-, et surtout, pas d'avenir. Ma grand-mère, parrain, et mon petit cousin de huit ans, arrivèrent le dimanche. Mon petit cousin était comme le fils adoptif de ma grand-mère et de parrain. Parrain était le mari de ma grand mère, comme un grand père pour nous. C’était ma grand-mère paternelle. Elle avait quitté un homme violent-et par obligation ses enfants-brutalement, alors que mon père avait dix ans. Cela l’avait sûrement traumatisé, d’autant que son père le frappait aussi. La relation particulière qu’il voulait construire avec ses filles avait certainement quelque chose à voir avec celle qu’il avait perdue avec sa mère. Il l’avait retrouvée à l’âge adulte, alors qu’il était indépendant. C’est en venant la voir qu’il avait rencontré ma mère, car elle habitait le même coin. C’est donc dans le cadre de relations familiales parfaitement normales qu’elle venait chez son fils. Elle venait le soutenir, ainsi que sa fille, dans l’épreuve que pouvait représenter l’hospitalisation de ma mère, et pour rendre visite à cette dernière, que mon père décrivait comme mourante. Ma grand-mère connaissait bien des défauts de son fils, mais elle ne l’aurait jamais cru capable d’inceste. Leur présence me protégeât le dimanche soir, mais elle m’installa dans le silence. Il me fut difficile de ne pas parler à ma grand-mère. Mais : Qu'aurait-elle pu faire pour moi? Surtout qu’aurait-elle pu faire contre lui ? Et aurait-elle pu cacher la chose à ma mère? Et si ma mère en était morte, comment aurait-elle fait pour me protéger? Et n’avait-elle pas assez peur de lui elle aussi pour ne pas le dénoncer? Et la police? Ce n’est pas moi qu’on aurait crue. J’aurais gagné une rouste. En plus. Je me posais interminablement toutes ces questions. Il n’y avait pas de réponses, pas d’issues. J'étais donc désespérément seule. Personne ne pouvait entendre, personne ne pouvait partager, personne ne pouvait me consoler. Ma mère rentra le 10 mai. Pour le moment le violeur m'imposait une complicité qui me répugnait. Il ne comprenait pas car il avait toujours cru qu’aucune femme ne pouvait résister à son charme. Selon moi, il aura terrorisé toutes celles qu’il aura connues, et elles l’avaient quitté. Y compris celle avec qui il s'était marié très jeune et avec qui il avait eu deux enfants, reconnus. (car il y en eut des non-reconnus). Le cas de ma mère était unique pour lui. Mais quelque chose clochait dans sa folie furieuse, et il lui fallait une réponse. Les différences que je pouvais présenter avec les autres femmes, à commencer par celle d'être sa fille, constituaient ce qui aurait dû donner un caractère unique, et surtout éternel à notre relation, dont il avait pourtant conscience qu'elle devait rester secrète. C'était LA différence qui faisait que j'allais lui appartenir, et ne pas le quitter comme d'autres l’avaient fait, y compris sa mère, et comme ma mère était censée le faire aussi, bien que malgré elle, par la mort. Il boudait comme un gosse qui aurait perdu au jeu. Je rompais le charme, en montrant plus de signes de tristesse que d’envoûtement. Il alla jusqu'à inspecter le lit, et déclara que je n'étais pas vierge. Puis il finit par trouver ma boite de pilules planquée dans ma chambre. Tout ça lui fournissait des explications! Peu m'importait, il m'avait déjà violée, il ne pouvait pas faire pire. Il n'avait qu'à continuer à me frapper, m'humilier et m'enfermer comme il l'avait toujours fait. Les premiers contacts que j’eus avec les autres me montraient à quel point on peut être dupe. Pourtant je ne cherchais à duper personne, le silence s’imposait à moi. Le dégoût devait être écrit sur mon front, tant il m’habitait. Mais personne ne semblait s’apercevoir de rien. Mon histoire glauque était à mille lieux de l'idée qu'on se faisait de moi. Il y a des choses qu’on ne veut pas voir, des questions qu’on ne veut pas poser. L’entourage ne m’invitait pas à parler, il m’invitait plus à me taire, implicitement. Et pourtant, c’était sûrement le moment où il fallait que je parle, pour ne pas m’enliser dans un silence dont je mettrais quatorze ans à commencer à sortir. J'en avais déjà conscience. Je m'étais juste libérée par écrit, dans une lettre dont je comptais me servir contre lui après mes dix-huit ans, lorsque je m’enfuirai, moi aussi. Ces pages m'ont suivie, bien cachées, jusqu'après que je sois devenue maman. Je les ai jetées, pendant une période où j'étais, si ce n’est dans le déni, dans un désir d’oubli, dans la peur que ces pages soient trouvées, me disant que tout danger était écarté, que tout ça c'était du passé, que je n'avais pas à revenir dessus. J’aurais aimé, au moins au début, qu’on devine ce que j’avais vécu sans que j'aie besoin d'en parler, et qu'on me protège de ce type. Le cap ultime du viol avait scellé le mutisme sur un contexte général dont j’aurais peut-être eu moins de mal à me libérer si ce viol n’avait pas pu avoir lieu. Le sceau du tabou, de la culpabilité d’avoir participé malgré moi et contre moi à quelque chose d’interdit et de sale. Quelque chose que la société d’alors était loin de considérer comme un crime, et qui était aussi l’objet à la fois de mystère et de curiosité malsaine. D’un climat plus que défavorable à la révélation. C'était le printemps. Période où les autres lycéens sont contents, que ce soit le printemps, et d'être bientôt en vacances. Moi j'aurais juste aimé dormir profondément jusqu’à mes dix huit ans. Il me restait son absence de la semaine, pendant laquelle je menais une autre vie, celle des copains-copines du lycée, où je ne foutais strictement rien, passant la plupart de mon temps à boire des coups au bistrot, et à fumer, quand les copains pouvaient fournir. Ça m’aidait à ne plus penser, à avoir des relations superficielles. J’avais réussi à être studieuse jusqu’en 3ème, non par plaisir, mais par peur. Au-delà, je n'ai été capable d'aucun apprentissage. La peur n’y pouvait plus rien, c’était juste trop difficile. Je mobilisais toutes mes capacités cognitives pour me protéger. Je n’étais disponible à rien d’autre qu’à ça. En vieillissant, j’ai gardé le sentiment d’être encombrée et habitée par moi-même et de ne pouvoir en sortir en développant par exemple un intérêt pour quelque chose. C’était un frein important pour mon rétablissement. C'était la fin de mon année de 1ère, pendant laquelle j'étais censée avoir de la chance parce que je n'avais pas cours le samedi matin. La chance était pour les autres, pas pour moi. Pour moi le samedi matin était juste un matin de plus avec mon père, avec qui je me retrouverais forcément seule de temps en temps puisque ma mère travaillait quelquefois le week-end. J'avais réussi à lui faire croire – à lui, pas à ma mère qui jouait le jeu-, que j'avais cours depuis le début de l'année. Je prenais le car avec tout le monde, et passais la matinée dans notre bistrot de lycéens où la serveuse était sympa et nous laissait rester même si nous ne consommions pas. Encore une fois les copains et copines ne comprenaient pas, mais ne cherchaient pas à comprendre plus que ça. Ils se contentaient de penser que mon père était sévère, mais aussi peut-être que j'exagérais un petit peu. Un de ces samedis matin, après les viols, il reçut un courrier du lycée qu’il appela et apprit que je n'avais pas cours. Je vis sa voiture avant qu'il ne me vit lorsqu'il se gara près du bistrot. J'allai me cacher aux toilettes et la serveuse me couvrit, avant de me persuader de « me rendre », et que je n'avais aucune chance. Je partis du bar en direction du lycée. Toujours en train d’inspecter le quartier, il finit par me tomber dessus. J’étais sûre de prendre encore des coups. Ce ne fut pas le cas. Il ne sut pas que ma mère était au courant. Je venais cependant, et malgré moi, de lui faire peur. Il n'avait pas été très fier d'avouer à l'administration du lycée s'être fait berné, et se méfiait des déductions que l'on pouvait en faire. On n'en fit malheureusement aucune, si ce n'est celle de me considérer comme une dévergondée préférant ne pas être aux prises d'un père « sévère », et qui avait probablement raison de l'être. On ne s'attarda pas plus sur le fait qu'un adolescent aime bien dormir quand il a la chance de ne pas avoir cours... Pour moi, c’était comme une preuve de plus que mes aveux ne seraient pas compris, une nouvelle invitation au silence. Pourtant, et malgré le fait que j’étais devenue imperméable aux apprentissages, l’institution scolaire était un secours. Elle m’a permis de percevoir ce que ma famille avait de toxique, de créer des liens ailleurs, de passer une grande partie de mon temps en dehors de la maison du malheur. Elle est un tuteur de résilience important lorsque c’est l’enfer dans la cellule familiale. Un mois passa, et ma mère dût à nouveau être hospitalisée le week-end. Pendant ce temps, mon bourreau avait perdu tout espoir de me séduire. Je réussis donc, à mon grand étonnement tout de même, à lui faire accepter qu'une copine vienne à la maison pour cause de révisions, ce qui aurait été jusque-là aussi peu envisageable que de sortir. Il n’était pas dupe mais accepta, son jouet était déjà cassé. Il se vengea en m'humiliant juste assez pour que j’aie honte de ses remarques de vieil obsédé tout le week-end. Il savait que la maladie de ma mère m’empêcherait de parler. Ce fut la dernière fois que j'aurais dû être seule avec lui. Il ne me resta plus qu'à supporter sa présence nauséabonde des week-ends. Heureusement, déjà à cette époque, et cela ne fit qu'empirer, il passait beaucoup de temps devant la télé, dans une maison suffisamment grande pour que l'on puisse ne pas être dans la même pièce que lui. Il avait cependant des loisirs comme le PMU, la pétanque, et les jeux de cartes. Il avait essayé de m'initier à ces derniers en me hurlant dessus et j'en avais conservé une honte de ne pas savoir jouer. Il m'humiliait quand je n'y arrivais pas. Le temps passa, avec ses événements, dont certains ont été parfois de réels empêchements à parler et à couper les ponts, à des moments où je m’en serais sentie capable. Il cherchait en moi ce qui pouvait lui prouver que je n’étais pas si traumatisée. Il se rassurait avec ce que je lui donnais à voir. J’avais une famille, des enfants, je menais apparemment une vie normale. Il se gardait bien de gratter le vernis. Cela lui aura permis de connaître ses petites filles. Il fit assez d'efforts dans son rôle de grand-père pour qu'il soit difficile ensuite de soupçonner le père qu'il avait été. Mon absence d’éloges sur ce père n’en disait pas long. Je me contentais de répondre brièvement aux questions de mes filles. Je ne mentais pas, disais que leur grand père s'était « bonifié », que je n'avais pas eu une enfance facile, jamais plus. Avant de parler à leur père, j'étais, de fait, seule attentive à son comportement envers elles. Mais j'avais vite compris qu'il ne s'intéressait pas aux petites filles. Leur père et moi sommes ensuite restés vigilants à son comportement général, tout en leur laissant créer des liens avec lui. C'est avec un grand effort de bienveillance dont je ne le croyais pas capable, qu'il leur apprit à jouer aux cartes. Il restait chiant parce qu'il ne supportait pas l'agitation des enfants. Mais je crois qu'il n'en revenait pas de la chance qu'il avait d'être grand-père. Ce statut le rendait fier et il cherchait la considération de ses petites filles en leur faisant des cadeaux maladroits, comme des peluches gigantesques. Le jour de leur naissance, il leur acheta une pile de journaux et de magazines du jour J. Il ouvrit et approvisionna-autant que son avarice le lui permettait-un compte d'épargne, selon une comptabilité très précise. Lorsqu'elles furent adolescentes, la sexualité était sortie de sa vie depuis longtemps, comme de celle de ma mère d'ailleurs. Pour les seize ans de ma première fille, il offrit le restaurant à la famille proche pour « célébrer » le fait qu’il allait lui remettre le fameux livret de caisse d’épargne dont il ne cessait de parler. Ce jour là ma fille le prit tendrement par le cou pour le remercier. Pas lui, il ne le faisait d’ailleurs jamais. Et je me souviens m’être questionné à ce moment là sur la possibilité de dire un jour quoi que ce soit à mes filles...Leur père savait déjà à ce moment là, mais je savais que ça ne suffirait un jour plus si je voulais en finir avec ça. Il leur est difficile aujourd'hui qu'elles savent, d'imaginer comment j'ai pu, et aussi leur père par la suite, les confier à leurs grands-parents. En fait c'était plus à ma mère qu'à lui que nous les confiions, (de manière occasionnelle, et rarement pour la nuit), mon père passant la majeure partie de son temps devant la télé. Il ne réclamait pas la présence de ses petites filles, et elles l’ennuyaient même au bout d’un moment. Je n'eus conscience que plus tard de la réelle toxicité de ma mère, même si je me méfiais déjà d’elle aussi, et de l’influence qu’elle pouvait avoir sur mes filles. Considérant le danger écarté, je restais une observatrice muette, mais cependant attentive, d'une histoire qui me laissait le temps de di(gérer) la mienne. Même si je pensais à l’époque que cette digestion difficile n’en finirait peut-être jamais, et que je ne savais absolument pas comment m’en sortir. Je n’étais ni inconsciente, ni en manque d’instinct protecteur vis à vis de mes enfants. Je connaissais trop bien, à mes dépens, quel genre de prédateur il avait été, et où il en était. Mais je n’ai jamais eu de réel doute sur le fait qu’il n’y avait pas le moindre risque pour me filles, et n’aurais pas supporté d’en avoir. Une d’elles m'aura dit un jour que je devais « avoir la gerbe » à chaque fois que je le voyais. C’est pendant mon adolescence que je l’avais surtout. Après c'était beaucoup plus complexe, j’étais dans un néant sentimental à son égard. Il me restait juste l’inquiétude de sa réaction face à mon éventuelle révélation. Ce qui est toujours resté difficile était de lui dire bonjour. Je ne posais jamais mes lèvres sur ses joues et m'arrangeais pour qu'il ne le fasse pas. J'avais fini par avoir une technique ultra rapide. Je m'arrangeais aussi pour n'avoir aucune promiscuité physique avec lui, comme être assise à côté à table. Papa : un mot que je ne prononçais jamais avec légèreté. Difficile aussi lorsqu'il se vantait de l'éducation qu'il nous avait donnée. Je me sentais comme bâillonnée. Quand nous passions du temps chez eux, c'était souvent pour un repas, et je faisais en sorte d'avoir suffisamment bu pour ne pas penser. C’était un vrai psychopathe. Comment ce fou allait-il réagir si je lui rappelais une vérité qu’il voulait mettre aux oubliettes? Il avait peur de moi, peur que je ne lâche ce dont pour ma part j'espérais qu'il crève. J’ai donc continué à faire comme si rien ne s’était passé, à m’offrir un avenir que, bien que difficile en dehors de « ma bulle », dont je parle plus loin, je pensais ne pas mériter avec ma réelle histoire, auquel j’avais un jour perdu espoir d’accéder. C’était essayer de ne penser qu’au bonheur de « ma bulle ». C’était aussi permettre à ma mère de vivre, puisqu’elle semblait ressuscitée…C’était avoir l’illusion que cela allait participer à ce que j’oublie...et que cet oubli me soit bénéfique. Puis le temps a fait que j'ai appris à connaître en ce père ce qu'il y avait de mieux. Même si ça restait globalement difficile, nous arrivions à avoir des bribes de conversations. Ce qui est sûr c’est que mon absence de sentiments a toujours été claire. La peur que j’ai eu de lui est immense, mais l’emprise mentale faible en fait. J’ai toujours su exactement où j’en étais à son égard. Sa télé l'aura tué en lui imposant la sédentarité. J'aurais préféré qu'il soit là au moment où j'ai parlé. Sa mort rapide et inattendue était tout de même un soulagement par rapport à celles que l'on aurait pu lui imaginer. De quelle plus belle mort peut-on rêver qu'une crise cardiaque pour quelqu'un qui aurait été probablement invivable s'il avait dû mourir à petits feux de quelque maladie que ce soit? C'est aussi celle que j'ai espérée chaque jour pour lui entre 12 et 18 ans, et même au delà. Ni victime, ni coupable, juste responsable Le retour de ma mère me protégea d’autres viols, mais je m'en protégeais déjà moi-même par mon manque de « collaboration ». Rien ne disait qu'elle était remise de son cancer, je ne voulais pas, comme je l’ai évoqué, la tuer en lui parlant. En fait j'avais au moins autant peur pour ma vie que pour la sienne. Il fallait qu'elle tienne jusqu'à mes dix-huit ans pour que jamais cela ne se reproduise. Si elle était morte, je pense que je n’aurais pas supporter de me retrouver entre les griffes du bourreau, et j’aurais été privée du chagrin de l'avoir perdue. On m’avait volé mes joies, mes peines aussi. Elle aura bien tenté une petite question, du style « Ca a été avec ton père ? » chuchotée d'une voix aussi discrète que maladive, et se sera contentée d’un hochement de tête, d’un silence ou d’un regard fuyant. Connaissant le risque auquel j'avais été exposée, elle ne pouvait pas faire moins, elle n'aura jamais fait plus. Se serait-elle rendue complice d'un acte criminel comme le viol de ses enfants ? Mon père pensait que non puisqu’il se méfiait d’elle. Mais elle l’était déjà du harcèlement qu’il nous faisait subir. Ma mère ne m'avait pas vraiment désirée. L'histoire qu'elle vivait avec mon père au moment de ma conception était trop peu idyllique pour qu'elle puisse être en désir d'enfant. Puis, pendant sa grossesse, elle espéra beaucoup avoir un garçon, au point que, comme elle n'avait prévu qu'un prénom masculin, c'est la sage femme qui m'en trouva un. Ça, elle ne s'en est jamais caché, parce que cela restait du domaine de l’avouable pendant les années soixante. Ce qu'elle ne disait pas, c'étaient les raisons de ses choix. Elle ne voulait pas un garçon seulement parce qu'elle avait déjà une fille, mais parce qu'elle pensait que cela satisferait le machisme de mon père et le rendrait plus aimable, moins violent. Que grâce à ça peut-être allait-il arrêter de la tromper, ou de draguer jusqu’à sa sœur, venue garder la mienne pour ma naissance ? Elle m'aima tout de même, à sa manière, en m'étouffant. Elle s'accrochait à cette nouvelle maternité comme à une bouée dans un océan de malheur. L'angoisse de ma mère et l'atmosphère que le bébé que j'étais devait absorber au quotidien a rendu notre relation fusionnelle pendant longtemps. J'étais un substitut d'affect. Je prenais une place particulière dans cette famille toxique. Plus tard, alors que j'avais environ neuf mois, elle a dû me laisser chez ma grand-mère. J'ai longtemps traîné un sentiment de vide, et la peur qu’elle parte à nouveau, dont je sais intuitivement qu'il date de cette séparation. Pour ne pas la perdre, je faisais tout pour être à son image, ne pas la décevoir. J’avais infiniment conscience de la fragilité de mon bonheur, sans savoir encore que celle qui pour moi le faisait allait aussi faire mon malheur. Cette peur d'être abandonnée, de ne plus être aimée, est un des boulets que je traîne encore aujourd’hui. Il se traduit par la phobie de faire quelque chose qui puisse déplaire à quelqu’un à qui je tiens. Physiquement, ma mère ne m'a donné que ses jambes, qui sont loin d'être ce qu'elle a de plus beau. Je pense que je serai toujours plus ou moins complexé par ces jambes, et c'est un élément du physique très important pour moi. Elle a donné à ma sœur ses beaux yeux. Cet état de faits a souvent été exprimé sans qu'il fut tenu compte de ce que je pouvais éprouver. Ma mère n'était tout de même pas du genre à se trouver des défauts. Elle disait de ses jambes qu'elles étaient belles « sauf les cuisses ». Du coup, même si elle voyait bien que j'en avais héritées, elle parlait plutôt de mes pieds, que j'avais soi-disant comme ceux de ma grand-mère paternelle, en raison d'un petit défaut de ces derniers. Pour ma part, et ce malgré ce défaut, je ne voyais aucun point commun entre mes pieds de petite fille et ceux déjà très abîmés de ma grand-mère. Plus tard, il fallut que mes seins soient petits, et que je sois chétive. Rien qui pouvait faire de moi la belle femme que ma mère était si fière d'être. J'ai donc grandi en comprenant que je devais plus compter sur mon cerveau que sur mon corps. Même si j'étais « mignonne », j'entendais bien que cela se rapportait plus à mon tempérament qu'à mon physique. Et en grandissant, plus à ma tête, qu’à mon corps. Pour ma mère, après tout, c'est ce qui ferait peut-être que je ne la quitterais jamais. Mais ce n'était pas forcément facile pour quelqu'un qui était tant attachée aux apparences et qui aura passé sa vie à tenter de les sauver. Je me suis beaucoup interrogée sur ce qui avait pu faire d’elle un genre de mère «incestigatrice ». Les porteuses de ce mal qui a besoin d’un vecteur pour se développer. Je sais que son père est mort d'un cancer lorsqu'elle n'avait que neuf ans. Elle disait avoir beaucoup souffert de la perte de cet homme dont il paraît qu'il l'aimait particulièrement parce qu'elle était sa première fille. Elle était de ces victimes précoces (d’inceste ? : je n’en sais rien, mais de conditions traumatisantes sûrement), prisonnières de ce statut dont elles se font une identité, qui entretiennent la violence, y compris contre elles-mêmes, au travers de leurs fréquentations. Toujours est-il que mon père n'était pas la seule de ses connaissances qui donnait dans les déviances sexuelles. Pour la première il s'agit d'une fréquentation qu'elle avait et qui aurait bien aimé que les choses soient plus officielles entre eux. Je devais avoir quatre ou cinq ans. Elle le voyait souvent, ils couchaient ensemble, sans plus. Là où les choses se compliquèrent, c'est lorsqu'elle voulut s'en servir comme nounou. Elle n'avait pas trouvé étrange que quelqu'un qui travaille sur ce dont je me rappelle être du genre « carrière déserte », puisse emmener avec lui une enfant de mon âge. Ce dont je me rappelle aussi, c'est avoir ressenti du plaisir dans des câlins qu'on me présentait comme des jeux « papa-maman », également que j'étais à moitié endormie lorsque ça se produisait, dans son camion, sûrement au moment de la sieste. Je me rappelle aussi m'être inquiétée le jour où il m'a demandé de toucher la chose qui sortait de son pantalon, et d'avoir refusé. Le soir même je racontais à ma mère les épisodes dont je ne me souviens pas du nombre, et rompais le secret qu'on m'avait demandé de garder. Les choses ne prirent pas vingt quatre heures et elle convoqua l'ami pour lui signifier l'arrêt immédiat de leurs relations. Il était le stéréotype parfait de « l'ami de la famille », y compris de mon oncle, et de ma grand-mère, dont on ne soupçonne rien et avec qui nous avions également passé des vacances. Il n'aura pas nié et disparut. J'ai le sentiment que ma mère l'avait congédié plus parce qu'il avait trahi sa confiance, que parce qu'il avait abusé de moi. Aujourd'hui j'ose espérer que de tels actes auraient immédiatement déclenché un dépôt de plainte. Mais ma mère pouvait me mettre à l'abri, pas vaincre sa honte. Elle aura toujours été très discrète sur le sujet. Certes, je lui avais présenté les choses avec la naïveté propre à mon âge, ne comprenant pa pourquoi un jeu devait prendre ce genre de tournure. Elle n'en aura pas parlé plus avec moi et je sentais que c'était un sujet à ne plus aborder. Lorsque je lui en ai reparlé tout de même, et ce après lui avoir révélé les viols de mon père, à 45 ans environ, elle me dit que la petite fille que j'étais lui avait raconté des jeux plutôt agréables avec ce monsieur. Elle n'avait manifestement pas compris les conséquences que ces soi-disant jeux pouvaient avoir eu sur moi. Voilà pourquoi je pense maintenant qu'elle a plus voulu punir l'intéressé que me protéger. Elle le punissait d'avoir pris des largesses avec quelqu'un sur qui elle avait jusque là l'exclusivité affective. Il lui avait aussi fourni le prétexte qu'elle ne trouvait pas pour évincer ce prétendant qui plaisait tant à sa famille. Dans le deuxième cas, il s'agit d'un couple d'amis dont la femme était une collègue de ma mère. J'aimais bien aller chez eux, c'était cool, surtout parce que la collègue de ma mère avait une fille d'un premier mariage, déjà adolescente dans mes premiers souvenirs, qui était très douce et très gentille. Je me souviens que les conversations des adultes tournaient souvent autour du fait que le couple voulait un autre enfant, et que les choses n'étaient pas forcément simples. Jusqu'à une certaine soirée, que nous avions passée chez eux avec mon père, alors que nous habitions déjà chez lui et étions venus dans le coin pour des vacances. Le couple avait eu depuis peu l'enfant désiré. C'était toujours compliqué de revenir avec lui, il nous rappelait à chaque instant que nous n'habitions plus là. Ça l'exaspérait de sentir l'envie que nous avions de revenir, et que nous ne voulions surtout pas vivre avec lui. En plus le fait de ne pas être chez lui l'énervait, et il était encore plus épouvantable que d'habitude, si tant est que ce fût possible. Nous ne pouvions pas respirer sans nous faire lyncher verbalement ou physiquement. Lors de cette soirée il avait réussi à me faire pleurer à table. Je me souviens que l'ami avait dit que je faisais « la comédie », et je l'avais détesté sur le champ d'avoir donné raison à mon père. Les autres ne s'étaient pas exprimé, par peur, comme c'était souvent le cas. Mais il était rare tout de même que l'on juge utile d'en rajouter pour lui donner raison. Les coalitions manifestes avec mon père n'étaient pas fréquentes, et je les avais mis tous les deux dans le même sac. Quelques années plus tard, l'adolescente de la maison, devenue jeune femme, quitta le foyer sans laisser d'adresse, alors qu'elle était enceinte. Le couple, se disant fâché avec elle, ne voulait pas en parler. Et enfin il y a la remarque que ma mère m'a faite après cette rupture. Elle pensait que l'enfant de la jeune femme était celui de son beau-père. Que savait-elle ? Et pourquoi avoir pensé les choses comme ça ? C'est comme si elle avait toujours raisonné, respiré, grandi dans l'inceste, et que ses relations, ou du moins celles qui duraient -peu nombreuses- se nourrissaient de ce poison. Elle avait pourtant une autre amie quand nous étions petites. Vivant seule, comme elle (si l'on peut dire), et ayant deux filles à peu près dans nos âges. J'ai un bon souvenir de cette relation, même si je lui reprochais de sortir avec ma mère pour aller voir des hommes. Je me souviens d'une femme qui assumait sa situation bien mieux qu'elle, et je n'ai pas souvenir de la moindre ambiguïté. Elle a rencontré mon père après que ma mère l'ait rejoint, et les deux amies se sont ensuite perdues de vue. Je ne sais pas pourquoi. Elle aura toujours été sous l’emprise de mon père, même pendant leur dizaine d'années de pseudo-séparation. Elle l'avait quitté sans qu'il en soit fâché. Il était plus libre comme ça qu'avec deux enfants à nourrir. Il nous rendait visite deux fois dans l'année. Deux fois qui, dans mes souvenirs de petite fille, étaient des événements très particuliers. Non pas seulement parce que notre père nous rendait visite, mais parce qu'il fallait sortir le grand jeu. Parce qu'il y avait des gaffes à ne pas faire, des choses à ne pas dire, notamment bien sûr parler des rares aventures amoureuses de ma mère. Il fallait attendre l'arrivée tardive du messie pour manger. Il fallait bien se tenir pour ne pas qu'il se fâche. Parce qu'il nous promettait des surprises et des cadeaux que bien souvent il ne faisait pas, se contentant de frimer avec les billets qu'il sortait de ses poches, nous en laissant quelques miettes. Parce que malgré tout ça, ma mère lui ouvrait son lit, comme si de rien n'était, et parce que tel était le désir de Monsieur. De ce Monsieur qui bien entendu ne lui aura jamais versé un sou de pension alimentaire. Dans son monde c’était les femmes qui payaient, seulement elles. Ma grand-mère maternelle, avec qui nous vivions, ne cachait pas la haine qu'elle avait pour lui. Elle quittait carrément les lieux pour aller chez un autre de ses enfants. Il est vrai que cela nous permettait d'être plus à l'aise, dans un appartement où nous manquions de lits. En effet, il fallait qu'une de nous dorme avec ma mère au quotidien. Nous avions choisi la règle de « chacun son tour », un jour sur deux. Ma mère pouvait ainsi distiller alternativement ses câlins, qui n’étaient rien d’autre que des débordements de tendresse. Mais un peu trop débordants tout de même, d’autant qu’ils ont duré même après que nous soyons partis chez mon père, pendant les jours où il n’était pas là. Elle nous vampirisait tour à tour. Celle qui se retrouvait à dormir seule ne le faisait jamais de gaieté de coeur. C'était bien sûr source de dispute entre sœurs. Je me souviens aussi, dans l’appartement de notre enfance, avoir dormi une nuit au cours d'une de ses rares visites, avec mon père et ma mère, je ne sais plus pour quelle raison. Mon père ne s'était pas pour autant privé de ce qu'il était venu chercher, et j'avais été réveillée par les mouvements du lit, à un âge assez avancé pour savoir exactement ce qui se passait à côté de moi. La vie de pseudo-célibataire de ma mère, et cet éloignement provisoire de mon père, lui aura juste permis, pendant une dizaine d’années, de se faire plaindre, et féliciter pour son courage. C’était pour vivre avec mon père qu’il en fallait, pas sans lui. Dans ces circonstances où, pour moi particulièrement, ma mère semblait tellement tolérante, j’acceptais très mal qu’elle ait d'autres aventures, cela me paraissait malhonnête, et elle aura pourtant réussi à me faire culpabiliser de mon comportement. Tout comme de mon envie de rejoindre mon père, envie que j’avais eue, comme tout enfant peut l'avoir légitimement lorsqu'il vit au quotidien, dans les années soixante dix, la grande différence de la monoparentalité, non assumée qui plus est. En fait, je ne faisais que ce qu'elle attendait de moi. J'étais l'objet d'une manipulation plus ou moins consciente. Même lorsqu'un jour elle me dit que mon père la battait lorsque nous étions bébés, comme pour que l'enfant de douze ans que j'étais ait bien conscience de la décision qu'elle prenait. Et comme si c'était à elle de la prendre. Ma sœur était aussi contente de partir, mais je n'ai pas de souvenirs d'échanges qu'elle aurait eu avec ma mère à ce sujet. Encore aujourd'hui je me sens dans l'obligation de me justifier. Pour moi rien ne pouvait venir contrarier la relation conte de fées que je voulais voir entre mon père et ma mère. La « réconciliation » de ces deux personnes rendaient les choses encore plus romanesques. Et puis le fait que les papas énervés puissent quelquefois battre leur femme et leurs enfants ne paraissaient pas tout à fait anormal à ce moment-là. Je ne voyais juste pas ce qui pourrait encore énerver mon père...Nous allions tous être heureux, et tout irait bien. Ma mère me rendait responsable d'un choix qu'elle n'avait déjà plus elle-même, tant elle était soumise. Il lui fallait une décisionnaire par procuration. Mon enfance avant l’arrivée chez mon père, malgré tout, m'aura tout de même dotée d'une capacité au bonheur. J'étais heureuse, ce grâce à l'entourage de la famille, et au fait que ma mère ne pouvait exercer son esprit possessif que dans un cadre restreint, tant elle avait besoin de cet entourage. Mais elle illuminait littéralement ma vie, et je pense que cet éblouissement aurait probablement mal tourné, même si nous n’avions pas rejoint mon père. J’aurais donc (presque) toujours gardé l'espoir d'être de nouveau heureuse, parce que je l'avais déjà été, après avoir vécu à neuf mois la rupture dont j’ai parlé. J’avais déjà été sauvée d’un malheur profond. Mais pour l'heure j’avais soi-disant choisi d'aller vivre avec mon père, et, maintenant que nous y étions il fallait bien s'en accommoder, puisque sans nous, elle aurait pu repartir sans problème. Elle me disait ça avec toute sa sentimentalité dégoulinante : « l'amour qui nous unissait auquel il fallait s'accrocher pour tenir le coup jusqu'à notre majorité». Tout pour me sentir doublement responsable, et de notre emprisonnement, et du sien. Souvent je rêvais que tout cela n'était pas arrivé. Je redevenais la petite fille qui adorait tant sa maman. Je me disais aussi que je recommencerai sûrement à l'aimer après mes dix-huit ans, lorsqu'elle aurait enfin la liberté de s'enfuir, comme elle le disait, et que nous pourrions enfin tout révéler. Elle eut un cancer du col de l’utérus après le départ de ma sœur, dont elle guérit. Pendant ce temps mon père m’a violé et je n’en serai probablement jamais tout à fait guérie. Puis elle eut une métastase au poumon après mon départ, dont elle guérit aussi. Juste après la mort de mon père, j’ai eu encore un espoir qu’elle « lâche-prise » et révèle quelque chose de positif. Tout ce qu'elle révéla c'est de l'hypocrisie, de la cupidité, et de l'égoïsme. La façon dont elle a réagi lorsque je lui ai enfin parlé, plus longtemps encore après la mort de mon père, me laisse tout de même perplexe. La sidération à laquelle je m'attendais n'était pas là, bien qu'elle ait dit ne rien savoir. J'ai pensé alors qu'elle aurait pu vouloir cacher le secret dont mon père se serait confessé pour se sentir moins seul avec ce dont il aurait enfin compris ce que c'était. Ceci l'aurait rendu plus acceptable à mes yeux, aux dépens de ma mère. Je pense qu’elle n’a jamais voulu de ces dépens là. Toutefois, lors d'un des groupes de parole auquel j’ai participé, une personne racontait le cas de quelqu'un qui avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec son compagnon abuseur envers ses enfants, en signe de désapprobation. Il avait été dit que cette pratique était fréquente dans les familles ayant ce type de déviance J'ai fait le lien avec le fait que mes parents faisaient chambre à part depuis peu de temps après mon départ avec Philippe. Ceci m'avait seulement rassurée jusque là sur le fait que mon père n'était plus sexuellement actif. Avant sa mort je ne lui donnais plus que très rarement de mes nouvelles, et de son côté elle ne cherchait pas à savoir si j’allais bien. Je n’allais la voir qu'en coup de vent lorsque j’allais voir mon oncle et sa compagne, juste pour que ces derniers n'aient pas à subir sa jalousie. Et puis il devait me rester quelque chose de l'ordre de la pitié pour cette femme qui ne finira pas tout à fait comme elle aurait aimé finir. A sa mort, pas de tristesse de ma part, plutôt un soulagement. J’aurais passé une période de ma vie à l’idolâtrer, une autre à me désenchanter de cette idolâtrie, et une autre à cheminer pour tenter de comprendre la nature de nos liens. Il y avait longtemps que j’avais fait le deuil de celle que j’avais idéalisée, de ce qu’elle aurait pu faire, ne pas faire, admettre, consoler, réparer. Elle fut une mère aimante, vampiriquement, disposée à sacrifier ses enfants pour les garder. Elle y sera presque arrivée, allant jusqu’à abuser de ma peur de la perdre et de celle de mourir, jusqu’à une extrême confusion. C’est ce presque qui fait que je considère aujourd’hui la vie avec respect. Le bonheur dans ma bulle Contrairement à tous les autres personnages de ce récit, celui dont je vais parler maintenant aura un prénom, le sien. C'est mon amour, mon compagnon… En décembre 79, huit mois après les viols, un soir de semaine bien sûr, j'étais allée au cinéma avec deux copains frère et sœur. Des amis que ma sœur -et moi- nous étions fait depuis notre arrivée dans le village et qui savaient que je ne pouvais pas sortir le week-end. Ils avaient dû penser à moi pour ça. Le grand frère était en âge de conduire, et avait donc pu nous emmener à la ville, nous sortir un peu de ce trou à rat. Je filais vraiment un mauvais coton. Heureusement, les autres lycéens avec qui je me réfugiais dans notre bistrot n’étaient pas tous dans le même état de perdition que moi. Rien ne m’intéressait sinon atteindre mes dix-huit ans pour m’enfuir de cette foutue baraque, et tout déballer. Six mois encore à tenir, et rien ne disait que je pourrais y arriver, ça dépendrait de l'état de santé de ma mère. Après le cinéma, le conducteur et plus âgé de la sortie décida de rendre visite à un autre copain, ancien du village, et qui avait depuis peu un appartement. Là, c'est la première fois que je le vis, assis par terre, le nez derrière une BD, ayant en même temps une discussion très intellectuelle, me sembla-t-il, avec son hôte. Je me disais déjà que ce garçon pourrait être mon prince charmant, dans une autre vie, celle des princesses. Je le trouvais beau avec sa barbe. Cela lui donnait un air original et surtout drôlement intelligent. Moi j'étais nulle en tout. J'eus l'impression de passer complètement inaperçue, ce qui était fréquent, et n’était pas une illusion. Je voulais qu’on me remarque mais étais dans l'incapacité de faire quelque chose pour ça. Je n’avais pas développé de charme, sûrement pour que mon père m’oublie. Je ne me sentais pas pour autant dégoûtée de l'acte sexuel : je ne considérais pas l'avoir vécu. J'étais paradoxalement pressée de savoir si je pouvais y trouver du plaisir. Dans l’intimité de mon lit et dans mes rêves, cela me paraissait possible. Je remarquais donc ce garçon, Philippe, que je n'avais jamais vu. Mais il n'était plus au lycée et sortait plutôt le week-end… Le week-end se situait dans l’autre monde. Il y avait le monde merveilleux de la plupart des gens, et le mien, pourri. Le lendemain, j'acceptai, par des amis du bistrot habituel, une invitation chez un copain que j'étais censée ne pas connaître. C’était Philippe, il habitait près du lycée, et surtout près du bistrot, en coloc avec quelqu’un qui ne travaillait pas et qui ramenait quelquefois des lycéens le midi. Je venais de rencontrer l'homme de ma vie, le père de mes trois filles, le témoin et l'accompagnateur des souffrances dont l’origine était ce passé morbide. Mon souffre-douleur aussi, qui aura dû subir mes colères, les tempêtes cyclothymiques pendant lesquelles j'étais à la merci de mes sentiments, de mes hormones, et ne contrôlais plus rien. Et il y avait aussi le bonheur : celui d’aimer, d'être aimée, d'être en vie, d'avoir des enfants. Trop de promesses pour ne pas gâcher une vie qui semble se remettre à les tenir. C’était comme si une partie de moi renaissait et constatait que son environnement n’était plus hostile, ce qui me rendait aussi d’un optimisme naïf, comme un enfant. Que de choses si improbables peu de temps avant, mais qui me faisaient me réfugier dans une relativisation proche du déni, de peur de les perdre, de rater la vie qui était devant. Mon vécu sordide me rattrapait néanmoins toujours. Mon histoire était l’ennemi qui s’infiltre dans tous les bonheurs, et dont je voyais bien que toutes mes tentatives de m’en éloigner ne faisaient qu’en faire grandir l’ombre. Plus tard, j'appris qu'il m'avait lui aussi remarquée par dessus sa BD la veille au soir. Nous avions tous les deux le même appétit amoureux et la sexualité de deux enfants de dix-sept et dix-neuf ans. Nous découvrions l’amour ensemble, même s’il était un peu expérimenté. Et ce que nous découvrions nous plaisait. Ce que je craignais n'avait pas lieu, je n'étais pas inapte au plaisir, même si je n’avais pas eu le goût de me masturber depuis les viols. Je compris plus tard que les dégâts causés étaient beaucoup plus diffus, et difficiles à cerner. Nous nous entendions sur les grands thèmes de la jeunesse, avions des goûts communs, écoutions « Just a perfect day» de Lou Reed les yeux dans les yeux. Nous étions aussi très complémentaires. Chacun de nous avait trouvé en l'autre ce qui lui manquait. Je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Je n'allais plus en cours, il n'allait plus bosser, nous fumions des joints, et restions au lit. Fumer des joints me mettait déjà un peu mal à l'aise, comme je l'explique plus loin, mais je faisais tout comme lui. Il avait heureusement accompli plus de chemin que moi et avait un CAP de Tapissier Décorateur. Il ne sut pour l'instant de mon père pas plus que le fait qu'il m’empêchait de sortir, et que je voulais quitter sa maison à dix huit ans. Un père moyennement despotique, comme il en existera toujours. Il était plus concevable qu'il en existe alors, et lui-même était parti de chez lui le jour de sa majorité, même si ce n’était pas du tout le même contexte. Cet écran de fumée a fait que, même s’il ne comprenait pas toujours mes comportements, il n’aura pas imaginé pire. Je me sentais tellement salie que je pensais qu'il ne m'aimerait plus si je lui parlais, ou que je lui ferais peur, et je voulais vivre à fond ces moments où j’avais l’impression d’être comme les autres. J’avais cinq jours de trêve sur sept. Cinq jours où je me sentais vivre comme une vraie adolescente, ici et maintenant. Si j'avais parlé, j'aurais dû aussi lui imposer ce secret jusqu'à mes dix-huit ans, ce qui me paraissait alors impossible. Je l’ai très vite présenté à ma mère, pour que nous puissions nous voir plus facilement en semaine. Elle était remise de son premier cancer, mais elle ne retravaillerait plus. Il pensait en toute logique que c’était une femme bien, victime de sa maladie et d’un homme « pas très cool », et prise au piège avec ses deux filles. Je n’ai pas cherché à le contredire. Je restais prudemment à l’écart de tout ce qui aurait pu me faire glisser dans des aveux. Malheureusement il dut partir à l’armée en février 80, et n’aura pas réussi à se faire réformer. Je n'avais pas dix-huit ans, et, pour continuer à le voir, il fallait que je trouve une solution. Les réactions de ma mère devant cette nouvelle tristesse auront fini de me détacher d’elle, même si je ne m’en aperçus pas tout de suite. Je pleurais beaucoup (je n’avais pas pu le faire depuis les viols bien qu’ayant le sentiment que cela m’aurait fait du bien). Je pleurais parce que nous n’allions plus nous voir, car il ne serait en permission que le week-end. Il n’aurait pas fait l’armée, j’aurais attendu avec lui ma majorité, et serais partie, comme ma sœur, sans qu'il ne rencontre mon père. J’aurais peut-être pu alors coupé les ponts. Mon histoire me donnait une raison de plus de détester l’armée qui aura joué ce rôle dans la continuation des relations familiales. En attendant, ma mère comptait sur l'éloignement de la seule personne qui comptait pour moi, pour me ré-apprivoiser. Elle le pensait seul responsable du changement de comportement que j’avais vis-à-vis d’elle. Elle n’avait plus d’emprise, ne pouvait plus m’utiliser comme substitut affectif. Elle n’avait accepté sa présence que pour tenter de se réconcilier avec moi, et parce que je ne lui laissais pas le choix. Le matin où je lui annonçais que j’allais parler de lui à mon père, elle n’a pas cherché à m’en dissuader, elle ne m’a pas aidée non plus. Elle pensait que cette démarche était vouée à l’échec. J’avais perdu toute confiance en elle, alors je me lançais seule, avec la consigne de ne rien dire sur le fait qu’elle le connaissait. J’avais vécu pire, et c’est ce pire qui allait m’aider provisoirement, mais pas seulement. J’adoptais hypocritement le comportement de n’importe quelle jeune fille de mon âge. Il ne s'attendait pas à un tel cran de ma part, et je sentis aussitôt sa gêne. Mais quoi de plus normal en somme pour une adolescente de bientôt dix-huit ans d’annoncer à son père qu’elle a rencontré un garçon qu’elle aimerait bien voir les week-ends ? C’est à ce moment que je me rendis compte du pouvoir que j’avais de le déstabiliser. Ma demande le mit mal à l’aise, et je pris immédiatement conscience qu’il avait peur. Il était fragile maintenant qu’il avait constaté que ses désirs d’avenir n’étaient que chimères. Le retour à la réalité lui faisait prendre conscience de ce qu’il risquait. En ce qui me concerne, j’allais pour le moment tirer profit de la situation, mais ne me rendais pas encore compte que la force que j’avais sur lui allait me nuire. La suite des événements fit que les choses furent très vite décidées. Sans l'aide du contexte, je pense que j’y serais arrivée, mais moins vite. Pendant des années je racontais, notamment à ma sœur, que ce sont les circonstances suivantes qui seules auront joué dans la décision de notre père. Nous eûmes à l’improviste la visite de son cousin peu de temps après que j’ai posé ma question d’adolescente. J’aimais bien ce cousin, il nous avait quelquefois défendues face à l'attitude autoritaire de mon père, ce que personne n’osait faire. Impossible pour lui de ne pas mettre au courant le nouveau venu, il n’arrivait pas à cacher son trouble. Il essaya tout d’abord de s’en faire un allié pour ne pas accepter. Non seulement la personne était mal choisie, mais je voyais bien que la peur que je lâche tout l’envahissait. Il y avait une brèche dans son monde, et il devait la colmater. Philippe appela alors même que les deux cousins débattaient, et que j’attendais une réponse à ma question. Il avait bu, et n’avait pas tenu compte de mes recommandations. Il voulait me voir. Je me retrouvai donc avec, au bout du fil, celui qui faisait l'objet de ma demande, entre mon père et son cousin, et posai simplement la question. Son cousin lui aura rendu le service de dire oui à sa place, et ne partit qu’après l'arrivée de Philippe. Ce dernier fût reçu d’une manière dont je fis longtemps mine de m’amuser, car il s'en amusait lui-même : mon père lui offrit un cigare et un cognac en lui disant que s’il arrivait à finir les deux, il était « un homme ». Pour voir Philippe, je venais de me tendre un piège dont je percevais mal la profondeur. Je lui en ai longtemps voulu de ne pas avoir réussi à se faire réformer. C'était injuste, il n'avait rien pu faire pour ça. Il ne voulait pas que de l'insubordination lui attire des sanctions qui lui feraient perdre ses permissions, et l’empêche de me voir. En ce qui concerne mon père, qui n’appela pas de toute la semaine qui suivit -cela ne s’était pas produit une seule fois depuis que j’habitais chez lui- il revint le week-end suivant avec des résolutions toutes neuves : Philippe pouvait venir quand il voulait. Ce changement radical fit que mon secret se referma sur moi. La vie, en tout cas ce à quoi je la résumais, c'est à dire mes rencontres avec Philippe, devint pourtant tout d'un coup plus facile et je perdis peu à peu le courage du retour en arrière. Le comportement de mon père m’effrayait autant qu’il me convenait. Mon problème à court terme était résolu, je savais que le long terme serait plus compliqué. Après la désillusion, la peur que je parle s’empara définitivement de lui. Il ne parvint jamais à colmater la brèche faite sur son monde. Il dut changer. De gré, de force ? Quant à moi, une bonne amnésie m’aurait empêché d’avoir honte. Mais l'amour m'avait redonné le désir de vivre. Alors pourquoi tout gâcher ? Je compare ce soulagement, au bout du tunnel auquel j'arrivais, à celui que j'avais déjà eu, lorsque ma mère était revenue quand j'étais petite. De la même façon, j'avais peur de gâcher ce qui était un retour au bonheur. Je comparais les dix ans de « trêve » pendant que nous n'avions pas vécu avec mon père, avec la vie pleine de promesses que je pouvais construire avec Philippe. Je m’étonnai de la relation entre l'homme que j'aimais et celui que je haïssais, même si elle n’a jamais été franchement cordiale. Mais ce dernier restait sur ses gardes, il savait ne montrer de lui qu'un caractère éruptif et se calmer quand il le fallait. La plupart des gens pensaient de lui qu'il était beaucoup moins monstrueux qu'il ne pouvait le faire croire. Les deux mondes de mon adolescence semblaient pouvoir ne faire qu'un. Plus obligée de mentir au quotidien, me cacher, calculer tous mes faits et gestes, rester enfermée, contre un secret gigantesque. Je n’eus évidemment pas mon bac. Depuis que j’étais majeure, je ne faisais qu’attendre le retour de Philippe pour m’installer avec lui. J'occupais mon été entre un remplacement dans une usine de confection, et des vacances chez ma grand-mère, pour ne pas être avec mon père pendant ses vacances. J'obtins ensuite des contrats en tant que femme de ménage à l'hôpital où il se trouve qu'à la fois ma mère avait travaillé, et le père de Philippe travaillait encore. Les week-ends je les passais ailleurs avec mon amoureux. C'est alors que je commençais à avoir peur de tous ceux en lesquels j’avais eu jusque-là confiance. Je n'avais plus confiance qu'en Philippe, en ma famille bordelaise vers qui je serais bien déjà retournée, et deux amis, une fille et un garçon. Ces phobies sociales ont pris corps au fur et à mesure que mon secret se refermait sur moi et dès l'instant où je n'ai plus pu me tenir la promesse de parler après mes dix-huit ans. Je fus contente de payer une pension à mon père dès mon premier salaire, qui me permit aussi d’apprendre à conduire. Ce serait bien utile pour les projets que nous avions. Je tentais donc l’aventure. Pas de problèmes pour les deux codes, que j’aurais dû passer, en raison des huit fois où j’aurais dû passer la conduite, dont deux après que nous ayons quitté cette ville. Mes capacités à conduire n’étaient pas plus à remettre en cause que n’importe quel autre jeune conducteur, mais ma peur de devoir être observée et jugée, pendant ne serait ce que vingt minutes, était bien plus élevée que la majorité des jeunes de mon âge. Ça aura été une, parmi tant d’autres, des entraves importantes de mon indépendance. Au retour de Philippe de l’armée, nous avons vécu ensemble, du printemps à l'été 81, à proximité des domiciles de nos parents. Mon père fit preuve de la plus grande discrétion et bienveillance. J'étais médusée. Philippe et moi cherchions tout de même à fuir, même si ce n’était pas pour les mêmes raisons. Il chercha et trouva du travail près de l’endroit où son frère se trouvait, dans le midi, où nous avons donc atterri pour un an. Je me sentais incapable de faire quoi que ce soit. En dehors de chez moi, tout le monde me faisait peur. Les phobies sociales et cette peur que le retour en arrière ne gâche l'avenir, ne me laissaient aucune énergie pour la divulgation de mon secret. Je pensais venir à bout de mes problèmes sans avoir besoin de parler. J’ai donc tenté de repasser mon bac par correspondance, plus pour remplir mes journées qu’autre chose. C’était un cocon intellectuel qui m'empêchait de penser. C’était un alibi pour mon incapacité à faire autre chose. Je n’ai néanmoins pas gardé beaucoup en termes de contenu. J’étais plus intéressée par les matières ancrées dans la logique et le bon sens, même si j’étais nulle en maths. Les dissertations de philo, et surtout leurs sujets, me faisaient carrément peur. Je l’eus d’extrême justesse. Je n'en revenais pas, cela me paraissait impossible. Bien que mon livret scolaire témoignait de mon néant lycéen, mon assiduité avec le CNED me valut d’assez bonnes appréciations, alors que j’étais loin d’avoir fini le programme d’aucune des matières. Même après le rattrapage, deux oraux qui n’auront pas rattrapé beaucoup, le jury m’accordera les deux points qui me manquaient pour devenir « passable » et ce en raison de ces appréciations. Puis ce fut un nouveau départ. Je voulais emmener Philippe au pays de mon enfance, retrouver les membres de la famille avec laquelle j'avais été heureuse petite. Cela me redonna de l'espoir sur le fait que tout était encore possible. Je traversais même une période que j'appelle « déni-défi », envers moi-même et les autres auxquels je voulais donner l'image de quelqu'un d'affranchie et de délurée, pour brouiller les pistes. Il y a une photo de moi à cette période, les seins nus sur la plage. Une façon de donner le change en étant du côté de celles qui faisaient ça à ce moment là, assez nombreuses finalement. Un jour une de mes filles est tombée dessus et l'avait gardée, pour illustrer le côté « baba-cool » que nous avions un peu alors. Elle ne savait encore rien, et je n'avais pas fait de commentaires. Il y avait mon secret, un monde intérieur qui s'imposait à moi. Dans ce monde , celui qui m'obsédait pendant mes nuits blanches, je m'enlisais. En termes de relations sociales, j’avais moins de difficultés avec les personnes qui avaient fait partie de mon enfance, mais seulement avec elles. Avec les autres, je dépensais beaucoup d’énergie pour retenir la partie de moi-même dont j’avais peur qu’elle ne me trahisse. J’avais des angoisses terribles à l’idée de les rencontrer, et de véritables attaques de panique lorsque je devais me confronter à des nouvelles têtes. Philippe et mes filles faisaient partie de cet espace intermédiaire que j’appelle ma bulle. C'est là que je construisais ma vie, à l'abri, entre la partie enfouie de moi-même et les autres, et bien que tiraillée entre vouloir et pouvoir parler. Pendant longtemps, beaucoup de mes rêves se terminaient par une sensation de douleur dans la gorge après avoir voulu pousser un cri et qu'aucun son ne sortait. J'ai toujours voulu dire ce que j'avais vécu , même si je ne l'ai pas toujours su. Je ne voulais pas que l'on s'apitoie sur mon sort, je voulais juste être comprise. La vie sexuelle dépendant de la capacité à s'abandonner, à ne plus penser, la mienne était par conséquent souvent compliquée. J’avais des orgasmes, mais ils se terminaient couramment dans un lâcher-prise qui se terminait par des pleurs. C'est donc dans la région de mon enfance que je tombais enceinte de notre première fille. Ma maternité prit toute la place et je ne voulais pas l’en-tâcher en revenant sur mon passé. Je voulais être résolument tournée vers l'avenir. C'est d'ailleurs peu après la naissance que je jetais ce que j'avais écrit après les viols. Nous avions des difficultés professionnelles, et de logement. Nous n'arrivions pas à nous ancrer socialement. Philippe n'était pas phobique, cela lui était difficile pour d'autres raisons. Nous fréquentions donc essentiellement la famille. En ce qui me concerne, mon bac général ne servait à rien sur le marché du travail, et j'étais de toute façon incapable d'en chercher. J'avais réussi à percevoir du chômage et des indemnités de maternité en raison d'un petit stage en informatique que j'avais fait avant d'aller dans le midi, et du fait d'avoir obtenu mon bac. A ce moment là c'était possible. L'avenir ne se présentait bien que dans ma bulle. Ma vie sociale était jalonnée par la peur. C'était comme si celle que j'avais jusque-là eue de mon père s'était diffusée à l'égard de tout le monde, et était devenue impossible à cerner. L'hostilité était partout dès que je passais la porte de chez moi. J'avais l'impression d'être continuellement observée, qu’un regard malveillant était toujours posé sur moi. J'avais peur d'être percée à jour, que l’on devine ce que j'avais vécu. Je cherchais toujours quoi dire aux gens, dans une quête de reconnaissance, en essayant de coller le plus possible à l’idée que je me faisais d’eux. Je voulais être reconnue mais surtout pas connue. Je voulais mettre à distance celle que j’étais, me rendre insaisissable en tentant de coller à l’image de l’autre. Mais mon côté caméléon avait ses limites. Lorsque je les atteignais, souvent dans des circonstances où il était question de mes enfants, je pouvais me défendre avec beaucoup de véhémence. Mais ça me rendait malade pendant des jours. Seul l'homme que j'aimais pouvait voir que quelque chose clochait et être assez patient. Ce que je vivais dans ma bulle avec ma fille et lui aurait été tellement improbable à peine quatre ans avant. Comment faire comprendre une telle horreur, même à la personne que l'on aime ? L'enfer de mon passé ne risquait-il pas de resurgir ? Je préférais pour l'instant vivre dans l'espoir qu'avec le temps j'allais réussir, soit à parler, soit à faire une croix sur tout ça. Mon nouveau statut de maman m'avait aussi provisoirement rapproché de ma mère. Elle fera pencher la balance pour que nous retournions vivre près d'elle. Elle s'était remise de son cancer de l'utérus mais avait eu une métastase au poumon, et rien ne disait encore qu'elle finirait par s'en remettre aussi. Nous avons atterri dans un village dans lequel tout le monde connaît tout le monde et où il est difficile de passer inaperçu. Le seul fait d'attendre chez le boulanger, et d'être soumise aux regards de la file d'attente, était un enfer. Toujours cette distorsion entre le présent prometteur auquel je voulais donner toutes ses chances, et ce passé pourri qui me guettait dans tous mes faits et gestes. Le présent c'était acheter chaque jour à ma fille le petit morceau de viande pour son repas, et le passé était le prix qu'il m'en coûtait d'être en vis à vis avec d'autres clientes de la boucherie. Les stratégies étaient du genre à éviter les heures de pointe pour ne pas avoir à faire la queue. Ma vie quotidienne était truffée d'embûches : plus tard aller chercher mes filles à l'école, ou encore aller à un rendez-vous médical, sortir et surtout avoir à rencontrer des gens... Avoir à remplir un chèque sans trembler à la caisse, insérer des disquettes dans un ordinateur sous le regard de quelqu'un, mettre mon bulletin de vote dans l'urne... Je consommais déjà souvent des médicaments, pour dormir, ou ne plus penser. Mais j'étais vivante, et je vivais entourée d'amour. Peut-être qu'un retour en arrière me ferait-il retourner dans la mort, et la haine, et que ce que je subissais n'était rien, à côté? Pendant la période la plus proche du déni, un peu avant ma grossesse, la communication avec mon père était ce que je souhaitais qu'elle soit à ce moment là, puisqu'il semblait visiblement encore plus dans le déni que moi. Et enfin, j'avais quelque chose qui ressemblait un peu à un père, moi qui partais de très bas sur ce point. J'avais trop peur des conséquences que pouvaient avoir ma révélation. Derrière son apparence présentable, un fou avait sévi. Je voulais vivre comme j'en avais envie maintenant, en espérant que les moments difficiles finiraient par se dissiper. Notre famille en vivait un aussi sur le plan financier, et c'est ce père qui me proposa de me pistonner pour rentrer comme guichetière à La Poste, ce que je n'avais pas les moyens de refuser, et qui nous dépanna bien pendant quelques temps. Cela avait été difficile. Non seulement que cet emploi vienne de lui, mais aussi d'accomplir ce travail qui me mettait en contact avec du public. Il était fréquent que le client qui se trouvait là me foute la trouille, et que je me mette à avoir des crises de phobies, qui étaient décuplées si peu qu'il y ait une file d'attente. J'aurais vécu des événements très pénibles, dont celui d'être le seul et unique témoin du vol de la caisse dont j'avais la charge. Rien qu'un hold-up de très petite envergure, perpétré en partie par le frère de copines d'enfance... mais qui bien sûr prit d'énormes proportions pour moi. Je me sentais souvent étrangère, parce qu'étrange dans mes réactions, sans vraiment savoir si ceux avec lesquels j'étais mal à l'aise ne préféraient pas que je reste à l'écart. Comme si je dégageais une différence qui dérangeait, et que cette perturbation venait à son tour nourrir mon mal-être. Comme si je ne me sentais pas légitime d’évoluer dans le même monde. Le trouble que je provoquais à mon insu pouvait aller jusqu'à faire adopter aux personnes une attitude méfiante ou méprisante. Le mépris envers quelqu'un qui se sent déjà différent n'est qu'une invitation à se replier sur lui-même. J'étais dans cette catégorie et je sais de quoi je parle. J’ai perçu ce mépris de personnes prétendument altruistes et ai appris à mes dépens leur faible disposition à l’empathie. Il y avait aussi le comportement infantilisant de ceux qui pensaient que je manquais juste de maturité. Il est vrai que mon physique de petite blonde, ma féminité refoulée, et ma peur, favorisaient cette perception des autres....C’est sûr. On a pas beaucoup le temps de s’occuper de sa maturité quand on doit passer son adolescence à bâtir des murailles pour se protéger. Par ailleurs j’ai pourtant eu à être adulte très vite. J’aurais préféré façonner ma personnalité plutôt que de devoir la refouler. J’aurais préféré que mon adolescence m’apprenne autre chose de la vie. Mon expérience pesait lourd, et ne laissait pas de place à d’autres, et c’est vrai que dans bien des domaines, j’étais naïve. En fait j’ai mis très longtemps à naître et à être, même si je pense que l’entreprise n’est jamais vraiment terminée, pour aucun d’entre nous. Je ressens encore aujourd’hui un sentiment d’être soit trop jeune, soit trop vieille, cette difficulté à avoir des relations avec des personnes de mon âge, même si je l’assume maintenant. Les rares personnes ne s'étant pas arrêtées à mon étrangeté, ont longtemps été trop peu nombreuses pour me permettre d'éprouver de la sécurité à l'extérieur de ma bulle. C’est un reproche à l’indifférence que je fais, plus qu’aux personnes elles-mêmes. Et puis nous avons voulu notre deuxième enfant. Encore une aventure formidable, en dépit d'un foutu contexte. J'en profitais pour arrêter de fumer des joints. Étant enceinte, on ne me demanderait pas de me justifier, et je ne voulais pas faire subir mes crises d'angoisse à ma fille. Cette deuxième enfant sera la seule de mes trois dont j'ai accouché sans péridurale. Le long déroulement de ces accouchements, pour lesquels on m'a administré des hormones de déclenchement, est certainement aussi la résultante de cette difficulté à m'abandonner. Et, malgré la douleur de ce deuxième, je suis aujourd'hui contente de l'avoir vécu comme ça. Les capacités que j'ai dû développer pour gérer cette douleur ont certainement été déterminantes pour la suite. La nécessité du lâcher-prise avec tout ce qui peut parasiter la concentration sur son corps, m'a été bénéfique, étant souvent dans le psychique, aux dépens du physique. Après l'allaitement, je me sentis assez forte pour continuer à ne pas fumer des joints. Je les passais au suivant sans y toucher. Cela me valut des questions et des remarques auxquelles je me contentais de répondre que j'arrêtais parce que « ça ne me convenait pas ». Finalement je m'aperçus que ce n'était pas si compliqué. Il m'aura fallu treize ans après « la rencontre » pour parler à mon amoureux. Mes deux premières filles avaient respectivement huit et trois ans. J'avais un emploi depuis moins d'un an, que j'avais trouvé moi-même, et dont j'avais envie qu'il dure un peu plus que tous ceux que j'avais eus jusque-là. Au début je m'imaginais que ces aveux allaient se lire sur mon front. J'avais ouvert un barrage tellement énorme. J'étais encore loin de pouvoir assumer ma différence avec tout le monde. Puis il ne fallut que quelques semaines pour que je sente les effets positifs sur ma vie sociale. Mon manque d'équilibre émotionnel était démultiplié dans mes relations de travail, et mes aveux m'aidèrent, entre autres, à ne pas abandonner. Les relations sociales restaient cependant compliquées. Les liens que je tentais de tisser me lâchaient encore, mais je souhaitais améliorer la perception que j'avais des individus. Philippe encaissa douloureusement, mais il était content que j'ai pu parler, et d'avoir des réponses. Il souffrit surtout de devoir continuer à rencontrer mon père, et de devoir garder le secret. Je ne trouvais pas encore assez de place pour cette sale histoire dans le contexte de l'époque : la vie douloureuse et compliquée de ma sœur, les liens établis entre mes filles et leur grand-père, ma mère toujours susceptible d'avoir un autre cancer. Bref, je ne me sentais pas prête, et j'espérais que ces aveux allaient suffire pour que je puisse au moins prétendre à un épanouissement, ce qui semblait déjà en en route. Nous eûmes notre dernière enfant six ans après. J'arrivais à un âge où il fallait se décider si nous en voulions un autre, et c'était le cas. Que du bonheur encore de l'avoir, malgré une grossesse plus pénible que les deux premières, et de gros moments de déprime. J'aurais aussi aimé l'allaiter plus longtemps, même si cela aura duré plus que pour ses sœurs. Périodes sensibles ces allaitements pour lesquels je sais que je les aurais vécu plus sereinement si je n'avais pas traîné cette sale histoire. Après cette troisième et dernière enfant, mes préoccupations maternelles s’accompagnèrent d’un vrai désir d’accomplissement personnel. Mes deux grandes filles me montraient déjà leur faculté à être autonome. Elles me montraient aussi que je pouvais m'occuper de moi maintenant, et je suis persuadée que je n'aurais jamais pu le faire aussi bien sans elles. Comme si j'avais besoin de les connaître pour me connaître. Une relation vouée à l'échec Je suis persuadée que le contexte de ma naissance était si toxique qu’il était incompatible avec la construction d’un lien paisible entre ma sœur et moi. Je me demande même si l’on peut vraiment parler de lien. Il s’agissait plus d’une interdépendance, dans laquelle elle s’était vu assigner le mauvais rôle en faisant de moi le bouc émissaire d’une violence dont elle avait manifestement été témoin petite. Cela se matérialisait par un désir de domination, quelquefois jusqu’au déni de ma personne. Elle ne supportait aucune expression de ma personnalité. Je me défendais souvent maladroitement. Nous nous jalousions aussi beaucoup mutuellement, sur des thèmes différents. J’ai mis longtemps à me rendre compte du rôle inconscient qu’elle a joué. Notre histoire ne commence pas le jour de ses dix-huit, lorsqu’elle a quitté la maison. Je lui en ai beaucoup voulu, de plein de choses, depuis notre enfance, mais pas de ça. Ça simplifie les choses de le penser, mais les choses ne sont pas simples. Elle pensait sincèrement qu’elle seule risquait quelque chose, et ce précisément en raison de la relation antérieure bancale que nous avions eue. Nous ne communiquions pas. J’en aurai peut-être voulu à une sœur avec qui j’aurais eu une vraie complicité, mais ce n’était pas le cas. Nous n’avions jamais vraiment parlé de mon père ensemble. Il y avait juste une entente tacite le concernant : il fallait s’en éloigner dès que nous le pourrions. Je n’aurais pas aimé non plus lui devoir d’être restée, car elle m’en aurait probablement fait porter le poids, et elle ne pouvait de toute façon pas le faire. J’avais peur bien sûr de me retrouver seule avec mon père. Mais à l’époque ma mère n’était pas encore malade, ce qui n’annulait pas les risques, mais les limitait. Je n’en étais pas à me questionner sur ce qu’elle aurait dû faire ou pas : il fallait qu’elle le fasse, elle n’avait pas le choix, et j’étais persuadée que j’aurais fait la même chose. Ce que j’ai éprouvé le jour de son départ, c’est un sentiment ambivalent de fierté et de jalousie, ce qui est très différent de lui en vouloir. Par contre, elle n’arrivera pas à comprendre ce qui m’est arrivée parce qu’elle considérait qu’elle seule était convoitée par mon père. Elle instrumentalisera mes aveux -sans les nier officiellement-pour se victimiser. De ça je peux dire que je lui en ai voulu. De ne pas m’avoir comprise alors qu’elle était censée le faire mieux que quiconque. Alors qu’une seule et unique chose nous différenciait dans le rapport à mon père : le fait que j’aie été violée. Je tiens à faire savoir ce que je sais, ce que j’ai éprouvé. Mon expérience dans le social m’a montré comment on peut extrapoler la vie de quelqu’un, et y plaquer de fausses vérités. En pensant aussi à toutes les femmes que j’accompagne, je me dois d’utiliser les ressources que j’ai pour passer le message. J’espère que cela pourra aussi éclairer ma sœur et ses enfants. Je ne leur souhaite pas de mal, et pense ne leur en avoir jamais souhaité. S’ils me lisent un jour et pensent sincèrement que je me suis trompée, je serais d’accord pour en parler. Ma sœur a connu notre grand-mère paternelle dès sa naissance. Ma mère avait dû finir sa première grossesse dans sa famille, proche de la mère de mon père. Puis elle dût rentrer à Paris seule, après avoir accouché. Elle n’aura pas eu le choix de la nounou. Mon père avait décidé que sa mère ferait l’affaire. Il n’avait pas tort sur ce point là heureusement. En même temps, il voyait ça comme un juste retour des choses. Sa mère qui l’avait laissé petit pouvait bien s’occuper de ses propres enfants. D’ailleurs elle s’occupait déjà d’une nièce, cousine de mon père. Le fait qu’elle habitait à six cents kilomètres de Paris n’était un problème que pour ma mère. Pendant cette période, ma grand-mère et ma sœur se sont attachées l’une à l’autre. Un des leit-motiv de l’histoire familiale était la coqueluche « très grave à l’époque », que ma sœur avait eue à trois mois et dont « Parrain » et ma grand-mère l’avaient sauvée... Après plusieurs allers-retours, ma mère avait été autorisée à ramener sa fille à Paris, alors qu’elle était enceinte de moi. L’autorisation n’émanait pas d’un homme ayant endossé le rôle de père, mais étant fier d’une charmante enfant qui marchait, avait atteint l’âge auquel on pouvait l’emmener dans les bistrots et en être fier. Je suppose que c’est à cette période que les ennuis ont commencé pour elle. Elle venait de quitter sa grand-mère , et j’allais bientôt accaparer sa mère. A dix-huit mois, alors qu’elle vivait avec trois adultes peu équilibrés (la sœur de ma mère était venue s’occuper d’elle à l’approche de l’accouchement de cette dernière), dans un studio, je débarquai. Cela explique peut-être le sentiment que j’ai longtemps eu d’être « de trop » à ses yeux. Notre père décida ensuite de nous confier toutes les deux à sa mère alors que j’avais environ neuf mois. Pas question encore une fois pour ma mère de rester avec nous. Elle ne nous vit que pour de courts séjours jusqu’à ce que j’aie un peu plus d’un an. Me voilà encore probablement « de trop » puisqu’après avoir dû partager sa mère, il a fallu que ma sœur partage sa grand-mère. Tout cela était bien chaotique pour nous deux. J’étais plus petite et devais donc demander plus de soins. On m’a toujours décrite comme une enfant très calme « qui ne pleurait jamais ». Je pense que je devais être inquiète. Ma mère venait de me quitter alors que j’avais neuf mois, et je me retrouvais dans un monde étranger. J’étais un peu « de trop » pour ma grand mère aussi. Mais l’époque était dure, et ma sœur et elle avaient établi une relation privilégiée. Ma grand mère me disait, lorsque j’ai été en âge de comprendre, que je ressemblais à sa propre sœur, avec qui elle était fâchée depuis longtemps. Mon mutisme et mon retard en toutes choses étaient racontés comme « une telle différence avec sa sœur qui était en avance sur tout ! ». Notre mère quitta ensuite Paris -pas vraiment notre père- pour revenir vivre avec ses filles. Un retour à une relative normalité pour l’époque, car les familles monoparentales étaient rares. C'est sur ces bases que notre petite fratrie s'est construite. Elle n'a jamais été très solide. Du plus loin que je me souvienne, je ne pense pas avoir partagé quoi que ce soit avec ma sœur sans que ça pose problème. Toute mon enfance, cette impression de déranger, d'être un fardeau, s’est poursuivie. J’étais encombrante, il fallait me réduire constamment. Je n’ai pas de souvenirs paisibles de jeux, de partage. Nous préférions ne pas jouer ensemble. Elle m’a maintes fois cassé des choses, ce jusqu’à ce que nous soyons adultes, dont j’ai dû faire les frais sentimentaux ou pécuniaires sans aucune compensation que le dédain à l’égard de mon soi-disant sens aigu de la propriété. Je ne lui faisais pas confiance et craignais qu’elle me demande des choses que je n’aurais pas pu lui refuser. Nous nous disputions beaucoup et nous nous frappions. Elle était plus forte et suffisamment plus grande que moi pour me taper sur la tête, ce qui faisait mal, et je finissais par avoir peur des coups. Mais je crois que ce qui l'énervait le plus, c'était mon côté insoumis, malgré tout. Elle voulait que je fasse tout ce qu'elle me disait, que je n'aie aucun libre arbitre. Je n'avais le droit d'être ni différente, ni comme elle, je devais juste être ce qu'elle décidait que je sois, souvent rien du tout. Elle m’influençait bien sûr, et je l’admirais secrètement, d’autant qu’elle était félicitée par tout le monde pour sa beauté et son intelligence. Elle avait « de beaux yeux comme sa mère », de belles jambes « comme sa grand mère ». Moi je restais « mignonne » sans plus. Elle fit de la danse, je ne fis rien. L’ombre au tableau en ce qui la concerne était plus psychologique. Ma grand-mère maternelle, avec laquelle nous vivions, disait d’elle qu’elle ressemblait à son père. Elle détestait ce dernier parce qu’elle savait la violence que ma mère avait subi de lui. Comme ma sœur était moins docile, elle ne dissimulait pas le lien de ressemblance qu’elle faisait. Ce ne devait pas être facile à porter. Un jour, et cela mérite d’être raconté je crois car c’est l’une des deux seules fois où j’ai senti un début de complicité entre nous. Nous étions d’accord pour demander à cette grand-mère, et faire un caprice, pour qu’elle nous achète du sirop. Cela paraît futile aujourd’hui mais à l’époque c’était très important, surtout pour des familles modestes. Mais il me fallut choisir entre devenir complice, éphémère sans doute, et grimper provisoirement dans l’estime de ma sœur, ou perdre celle de ma mère. Je m’étais dégonflée, j’avais trop peur que ma maman ne m’aime plus. Ma sœur avait dû assumer seule, et je n’avais pas pu avouer à ma mère. Cette crainte de perdre l'amour de ma mère était omniprésente, et pouvait m'angoisser des nuits entières. J'avais toujours très peur de la décevoir, de ne plus être "sa plus mignonne, sa plus douce", celle qui ne faisait jamais de bêtises. Elle me faisait du chantage affectif, et nous comparait beaucoup l’une à l’autre. Je crois que j'étais paniquée de la perdre vraiment, comme je l'avais déjà perdue. Cet événement était venu justifier le fait que j'étais une traître et donc infréquentable. Au début, je m'en fichais, de toute façon ça ne changeait pas grand-chose à notre relation. A l'adolescence, le récit de la "trahison", toujours sur le mode victime, qui me faisait passer pour ce qu'il y a de plus détestable, sonnera beaucoup moins bien. Le problème c’est que cette histoire n’a jamais vraiment été réglée entre nous. Nous n’en avons jamais parlé avec le recul qu’elle méritait. La dernière fois qu’elle a été abordée, par elle, nous avions une vingtaine d’années, c’était encore un reproche. Quant à moi je me suis longtemps sentie coupable. Je lui ai rendu par la suite bien souvent service sans que cela ne change radicalement la nature de nos rapports. Ces faits sont une description parmi tant d’autres de la manière dont la souffrance des adultes peut se traduire chez les enfants. Je n’ai de compte à régler qu’avec la situation, et plus avec personne en particulier. Au contraire, je tiens à nous décentrer d’une position victime-coupable à laquelle nous étions assignées, sans alternative, et qui nous a beaucoup nui. Je tente plus de m’intéresser en quoi, pourquoi, et dans quel contexte, notre relation était ce qu’elle était. Ma mère était incapable d’y voir clair et de nous aider. Elle était juste obnubilée par le fait qu’on l’aime. Elle me consolait quand j’étais triste sans apporter de cadre à ma sœur, ce qui rendait cette dernière encore plus hostile à mon égard. Elle devenait le mauvais objet et je pense que ma mère la craignait aussi. Moi j’étais la candidate idéale au chantage affectif tellement j’avais peur de perdre l’amour de ma mère, ou de la perdre tout court. Puis vint le cataclysme de l'arrivée chez notre père. Son comportement, qui était globalement le même pour chacune de nous, aurait pu avoir l'unique avantage de nous rapprocher. Il n'en fût rien. Voici quelques exemples de ce comportement : Parmi bien d'autres choses, il ne supportait pas que nous portions des pantalons, sauf pour aller faire le sale boulot qu’il ne voulait pas faire lui-même dans le jardin. C’était plus facile pour ma sœur de porter des robes ou des jupes, moi je n’étais pas à l’aise. J’avais honte de sortir avec les robes qu’il m’obligeait à porter. Certes, quand il était là, nous ne sortions que très peu, et jamais sans lui, si ce n’est pour aller à cent mètres chercher le pain. Il nous envoyait aussi chercher les bouteilles de gaz que nous devions mettre pleines sur un mini vélo que nous avions par conséquent bien du mal à manœuvrer sur le retour. Il avait trouvé cette combine, de nous faire marcher à côté du vélo plus petit que la bouteille qu’il portait, pour s’éviter cette corvée de gaz. Je me souviens des traversées du bourg de ce village-rue marchant à côté de mon vélo, que je maintenais et dirigeais difficilement, en ayant honte de ma condition de fille d’un tel père. A la maison, ces obligations vestimentaires n’étaient qu’une autre façon de nous faire subir son harcèlement. Il essayait de toucher nos seins, nos fesses, toujours attaché à son mythe du « dressage et du cuissage ». Ma mère s’en offusquait, il la repoussait violemment. Le fait de n'avoir pas la moindre approbation de notre part, et de nous faire prendre la fuite ne le décourageait pas. Il ne s’enfermait pas dans la salle de bains, et trouvait des prétextes pour nous y appeler lorsqu’il était allongé dans la baignoire. Il nous empêchait de nous y enfermer, et venait nous y déranger. A chaque fois, notre refus le faisait, selon son humeur, ou rire, ou crier. Il était de ces psychopathes pour lequel la révolution sexuelle des années soixante dix avait été comprise comme une porte ouverte à leur déviance. Il s’était fait une idée de l’éducation sexuelle qui consistait à ne plus avoir de pudeur, plus d'intimité. C'est précisément ce qu'il prétendait faire avec nous : notre éducation sexuelle. En même temps, il utilisait des idées très rétrogrades pour servir sa cause. Il nous sortait des trucs déjà plus d'actualité officielle, mais tellement encore d'actualité officieuse, comme le fait qu'il avait tous les droits sur nous. Sa perversité avait toujours le même objectif, le même fantasme, la même obsession. Ce n'était pas le genre de pédocriminel qui aurait pu arriver à ses fins bien plus vite, s’il s’était intéressé aux fillettes, mais un fou voulant trouver les moyens de s'approprier notre future sexualité. Lorsqu’il était en colère, ce qui était une seconde nature pour lui, le harcèlement faisait place à la violence. J’aurais pris des coups, mais pas autant que ma sœur, qui aura eu un jour le visage complètement tuméfié. C'était le seul point sur lequel il aura fait une petite différence entre nous. Je pense qu’il croyait, en raison de son apparente maturité, qu’il aurait plus de mal à la dompter que moi, ce qui le rendait plus violent. Il vivait avec elle dans l’inquiétude de ne pas avoir le temps de la « posséder » pendant sa virginité. Ses «projets» étaient cependant les mêmes pour chacune de nous. J’étais la seule à le savoir. Ma sœur ne voyait pas les risques que je courais. Nous étions ses choses, ils voulaient nous posséder, et nous garder, pour lui seul. Comme je l’ai dit, je n’ai eu que des petits flirts avant quinze ans. Après, à l'âge où les choses peuvent aller plus loin, je n’intéressais plus les garçons. Et je faisais beaucoup plus jeune, que mon âge certes, mais surtout que ma sœur. Je suis sûre que cela ne m’a pas aidée : c’est con de sortir avec la petite sœur d'une nana qu'est vachement mieux. Et, compte tenu de notre faible différence d'âge, nous avions toutes les deux la même bande de copains. Mais elle ne supportait pas que je sois sur son chemin. C'est fréquent, certes, mais dans ce cas, c'était exagéré. Lorsque quelqu'un remarquait en sa présence que j'avais peut-être plus de maturité que je ne paraissais en avoir, que je pouvais tenir des propos intéressants, elle rectifiait en parlant avec ironie de l'intelligence très "relative" de sa sœur. Je ne faisais pour elle que tenter de la copier. Elle se moquait très souvent de moi, et souvent en public. Quand nous n'étions que toutes les deux, elle m'ignorait, ou me critiquait. Lorsque nous avons été adultes, elle me présentait toujours ses amis comme les meilleurs du monde. Elle faisait en sorte que nous nous fréquentions, par bonté d’âme envers Philippe et moi qui n’avions pas beaucoup d’amis. En fait ce n’était encore qu’une façon d’avoir du pouvoir. Lorsqu’il arrivait que la relation avec une de ses connaissances d’origine devienne plus importante, elle tentait de la relativiser. Les ami(e)s, rares, que Philippe et moi nous faisions seuls, et que j’étais à la fois inquiète et fière de lui présenter, semblaient toujours suspects et soumis à un jugement très sévère. Une année, pendant des vacances d'été, entre 75 et 78, mon père, pris de je ne sais quel élan de générosité, nous avait laissées partir seules avec notre mère chez ma grand-mère paternelle, pendant qu’il travaillait. Je me rappelle de cette semaine comme d'un oasis dans le désert. C'était possible, on pouvait respirer et bouger sans avoir peur. Peur d'être traquée, touchée, regardée, battue, grondée, harcelée, surveillée, moquée, insultée, dégradée, humiliée. Et cela avait été comme si une marche arrière, tout au moins une manœuvre pouvant éviter l’obstacle actuel, était permise. J'avais voulu y croire, jusqu'à notre retour, en souhaitant de toutes mes forces la mort de mon père de toutes les manières possibles et imaginables. Le jour de ce retour, dans la voiture, à quelques mètres de la maison de ma grand-mère que nous venions de quitter, je sanglotai. Ma mère était elle aussi affligée. Elle n'a cependant pas compris mes pleurs tout de suite et s'est énervée contre moi. Le deuxième et dernier moment de complicité avec ma sœur a eu lieu à ce moment là, lorsqu’elle lui a demandé de me laisser, et ce de façon autoritaire. Ma mère obtempéra, ma sœur n'en dit pas plus. Ce moment est resté gravé comme quelque chose d'inhabituel dans nos relations, et je m'en suis souvent souvenue comme un espoir de début de quelque chose entre nous. Pendant ces quatre heures de retour pour l'enfer, nous étions toutes d'une tristesse démesurée. Nous avions même dû espérer que ma mère ne reparte pas. Je sais maintenant qu'elle n'a jamais vraiment eu l'intention de quitter mon père. L'avait-elle déjà réellement quitté ? Avait-elle déjà décidé quoi que ce soit ? Ma sœur et moi avions décidé. Nous comptions les jours avant notre départ, le jour de nos dix-huit ans, c'était la seule chose à laquelle nous pouvions nous accrocher. Mais nous n’en avons jamais vraiment parlé ensemble. Ce parce qu'elle avait été aveugle aux intentions pourtant non dissimulées de mon père me concernant, et avait toujours pensé qu'elle seule était sexuellement convoitée. Cet aveuglement n’était pas sans rapport avec la vision qu’elle avait toujours eue de moi. Elle n’arrivait même pas à voir que je risquais au moins sa rage ou sa violence, même si elle en avait été témoin. Voici où nous en étions jusqu'à ce qu'elle soit partie de la maison. Après, nous nous sommes très peu vues. Elle avait quitté le lycée, et vivait avec celui avec qui elle sortait à l'époque et qui lui avait rendu le grand service d'avoir un appartement. Moi j'étais le bébé. Elle était déjà dans un autre monde, celui de la défonce, si "douce" soit-elle. Elle eut le temps de rencontrer ensuite sa vraie idylle, celui qui deviendra le père de ses enfants. Une personne avec laquelle je ne me suis jamais vraiment entendue. Je ne m’attarderai pas sur ce que je savais de son enfance, mais ce qui est sûr est qu’il était malheureux dans son milieu d’origine, et qu’il n’assumait probablement pas celui qu’il avait choisi. Pour moi, il était profondément malade. D’une maladie qui pouvait le rendre charmant aux yeux de beaucoup de gens, avec beaucoup d’aura et de capacités relationnelles, et purement infréquentable pour d’autres. Dont moi. Et je pense pouvoir dire qu’il aura fait tout son possible pour ça. Et en premier lieu, sûrement inconsciemment aussi, faire tout pour que la relation entre ma sœur et moi n’évolue pas. Ses problèmes d’addiction exacerbaient son inconstance. Je le savais violent avec ma sœur, tout le monde le savait d’ailleurs et n’en disait rien...L’occasion de le dire m’est donnée, je la saisis. Après cette rencontre, elle décida tout de même de partir un peu voir ailleurs, sans rompre réellement. Similitude étrange avec la relation que mes parents avaient eue dans leur jeunesse. Nous habitions le midi lorsqu'elle réapparut, il se trouve que ses différentes connaissances l'avaient amenée jusque-là elle aussi, à environ deux cents kilomètres. Elle cohabitait avec une fille qui se défonçait encore plus qu'elle. Elle travaillait dans un bar à hôtesses, avait grandement conscience de son charme et en usait, comme ma mère en avait usé à son âge. Comme elle également, elle était déjà sous l’emprise de l'homme violent qu'elle ne maintenait à distance que temporairement, et avec qui elle retournera. Elle avait recommencé à avoir des contacts avec mon père. Elle n'avait pas cessé d'en avoir avec ma mère, et cette dernière avait su jouer les réconciliatrices. La distance faisait que, pour elle comme pour moi, les réunions familiales étaient rares. Un jour Philippe et moi étions allés la voir. J'étais toujours dans l'illusion qu'il était possible que nous ayons des relations « normales ». Il avait été décidé de voir du même coup le copain chez qui j'avais rencontré Philippe, qui habitait à ce moment-là, par hasard, la même ville. Cela m'était difficile mais je l'avais fait parce que Philippe y tenait et n'aurait pas compris ma réticence. J'allais mal à chaque fois que je devais rencontrer des personnes nouvelles, mais aussi des personnes qui faisaient partie de mon univers au moment où j'ai été violée. Ce sont ces mêmes personnes qui m'avaient permise, à ce moment-là, de ne pas être complètement isolée, mais avec lesquelles la frustration de ne pas parler avait été la plus forte. Leur présence me renvoyait la dépression dans laquelle j'étais après les faits, alors que je n'avais pas encore parlé mais souhaitais le faire après dix-huit ans. Les joints exacerbaient ma parano, je ne la contrôlais pas, c'était insupportable. Je me souviens de ces moments comme des calvaires. Lorsque nous fumions et que tout le monde commençait à rigoler, la panique m'envahissait en même temps que les autres paraissaient se liguer contre moi, dans le monde de la drogue qui les rendait heureux, eux. Quand j'étais trop défoncée j'avais l'impression qu'ils riaient de moi. Je me sentais prise au piège, j'avais la hantise de me dévoiler en refusant de fumer dans un univers où chacun y trouvait son compte, y compris Philippe. Dire ce que je ressentais était inconcevable. C'était avouer que j'avais été violée, c'était donc avouer que j'étais anormale, que j'avais ce handicap qui faisait de moi une pauvre fille. Lors de ce rapprochement, je m’étais retrouvée dans cette situation dans la soirée, pendant laquelle beaucoup de joints avaient tourné. Ma sœur avait jugé utile de reparler de « l'incident du sirop », dans l’intention non dissimulée de se venger encore en me décrivant de façon négative. Non seulement elle n’avait pas tenu compte du fait que nous n’étions pas seules, mais c’était là même tout l’intérêt de son récit, me décrire sous mon vrai jour, y compris à mon copain. J’avais pleuré dans mon coin le reste de la soirée. Philippe était venu me consoler plusieurs fois, je lui avais demandé de me laisser seule, il ne comprenait rien à tout ça. Elle ne se sera pas excusée, ne sera pas venue me voir. Elle tomba enceinte de quelqu’un qu'elle n'aimait pas et voulut garder l'enfant seule. Enfin pas tout à fait seule puisqu'elle vint squatter chez nous qui venions d'arriver à côté de chez ma grand-mère paternelle, dans la région de mon enfance. Je pense qu'elle avait vu là un certain nombre de tuteurs potentiels pour cette maternité et parentalité qu'elle aurait été en difficulté d'assumer seule. Moi j'étais plutôt contente que ma sœur soit enceinte même si je la sentais venir. Je ne lui ai pas fermé ma porte, mais n'ai pas accepté ses dérives. Ces dernières étaient du genre : je me défonce à mort, j'investis l'argent de la CAF pour dealer, je ne paye rien aux frais que j'occasionne, je casse les voitures qu'on me prête, et je pourris la vie de mes hôtes dès qu'ils s'avisent de ne pas être d'accord avec moi. Son train de vie la mena droit vers une fausse couche, dont j'étais la responsable en raison de mon manque de bienveillance. Elle refusa de me parler lorsque j'étais allée la voir à l'hôpital. Elle repartit ensuite retrouver l'homme de sa vie, et avec lui sa violence, et son manque de stabilité. Parallèlement, elle revoyait mes parents, de plus en plus souvent. Je fus maman avant elle, cela ne fit qu’attiser une jalousie latente. D’autant plus qu’elle me considérait plus heureuse qu’elle. Notre fille a neuf mois quand nous faisons le choix insensé de retourner vivre à côté de chez nos parents. Nous la retrouvons donc, et elle passait souvent ses dimanches avec nous. Son compagnon passait les siens avec sa famille, chez laquelle elle n’a pu aller que bien plus tard. Elle n’était pas franchement désintéressée dans cette reprise de contact. Elle était en désir d'enfant et voulait se rapprocher de celle que j'avais. Elle voulait se donner le courage d'en avoir un, et prouver à son conjoint que c'était possible. Mais la défonce était toujours là, et rien de stable autour de ce couple pour lequel la notion d'engagement était compliquée. Ils bossaient à Paris et ne rentraient que les week-ends. De mon côté j'étais encore une fois entre l'envie de construire une relation avec elle, et celle de la tenir à l’écart. Je la craignais et l'admirais à la fois, comme toujours jusque là. Mais je n'étais pas seule à avoir cette ambivalence de sentiments à son égard. Un peu comme mon père, il émanait de sa personne une rage contenue, une colère tapie dont elle arrivait toujours à rendre quelqu’un responsable, et dont beaucoup de personnes se méfiaient. A entendre la virulence dont elle, et son compagnon, faisaient preuve envers les personnes à qui ils en voulaient, on préférait être de son avis. En ce qui me concerne, il m'a toujours fallu beaucoup d'efforts pour m'opposer à elle. Mais je le faisais lorsqu’elle atteignait mes limites, quoi qu’il m’en coûte. Elle était celle qui avait pu s'extraire du danger ultime auquel nous étions exposées ensemble. Si je devais un jour parler, je me disais que ce devrait être avec elle. Mais je ne trouvais toujours pas la complicité qui me permette de le faire. Il nous sera arrivé de parler de notre père, mais surtout pour reconnaître qu'il avait changé. Nous ne sommes que très rarement revenues sur ce qu'il avait été. Je suis sûre qu'elle pensait qu’il avait changé grâce à elle, qu'elle lui avait ouvert les yeux en s'enfuyant. Elle ne le disait pas et exprimait plutôt sa culpabilité sur le fait d'être partie. Elle n'était pas plus prête à entendre les choses, que je n'étais prête à les dire. J'étais vraiment malheureuse d'être dans l'incapacité de lui parler. Finalement, et sûrement parce que nous étions à la recherche de relations que nous avions du mal à avoir seuls, et que Philippe aimait bien fumer des joints, nous finîmes par accepter d'être avec eux toutes les fins de semaine. C'était aussi parce que ma sœur était souvent seule et triste, et que nous ne pouvions souvent pas la laisser comme ça. Cela ne l’empêchait pas de m’utiliser comme bouc émissaire. Je sentais aussi que c'était plus notre fille que nous qu'elle voulait voir. Et son copain finit par s'y intéresser aussi. Notre vie de la semaine était tranquille et introvertie. Celle du week-end pleine de « copains » et de fumeurs de pétards. Ils rentraient de Paris plein de vantardise de vivre dans la capitale et d'avoir beaucoup de choses à nous apprendre. Moi j'aimais bien ma vie de la semaine. Triste similitude avec mon adolescence. Ce que je n'aimais pas c'était la solitude de mon secret. Les copains de ma sœur me faisaient peur souvent, comme tout le monde d'ailleurs. Certains sont quand même devenus des amis. De temps en temps j'exprimais mon ras le bol de son omniprésence, et nous nous disputions. Mais globalement, je faisais tout pour lui plaire. Jusqu'à envisager un jour d'acheter une maison et d'y vivre ensemble. Chose qu'elle était loin de pouvoir imaginer de faire avec celui dont elle voulait un enfant. Non pas par manque d'argent, il avait des parents suffisamment riches, mais par manque de courage. J'avoue avoir moi-même été séduite par le fait que c'était sûrement plus facile à deux couples qu'à un seul, vu notre petit budget. Mais j'avoue aussi avoir très vite voulu faire machine arrière quand j'ai vu la tournure que prenaient les choses. Nous aurions pu, puisque nous travaillions tous les deux, avoir le prêt qu'il était facile d'avoir à l'époque, pour notre projet. Au lieu de ça nous nous sommes vus dans l'obligation d'emprunter aussi de l'argent à mon père, argent qu'ils étaient censés lui rembourser, alors que nous nous chargions des prêts principaux. C'est ainsi qu'en 1987, nous achetons une maison, ensemble officieusement, et Philippe et moi seuls officiellement, le copain de ma sœur ne voulant prendre aucun engagement financier. Pour ne pas faire cette bêtise, il aurait fallu que je ne sois pas tant fascinée, et terrorisée. Il aurait fallu que je ne craigne pas de l'enfoncer en faisant ce qui aurait eu l'air d'une mise à distance alors qu'elle avouait parfois vivre l'enfer, et que nous avions eu l'occasion de le constater. Pour elle, et toujours par rapport à elle, j'étais tellement heureuse que c'est à peine si je pouvais me permettre un vague à l'âme. Toute défaillance de ma part prenait des allures égoïstes, puisque j'étais « tellement plus heureuse qu'elle ». Mon copain était gentil. De quoi pouvais-je souffrir ? Ma vie n'était toujours considérée qu'en comparaison de la sienne. Nous nous sommes retrouvés pris dans un piège dont nous avons mis quatre ans à nous sortir. Quatre ans pendant lesquels, j'ai tout d'abord été enceinte. Je n'ai bien vécu la période de ma deuxième grossesse que lorsqu'ils n'étaient pas là. Le désir d'enfant de ma sœur était devenu assez fort pour qu'elle soit jalouse de moi, et elle devait faire pression sur son compagnon pour avoir un enfant. Même pendant cette grossesse, je n’ai aucun égard de leur part. C'était l'inverse. Comme pour ma première fille, ma sœur ne s'est pas organisée pour venir me voir à la maternité, et elle eut un autre prétexte pour la troisième. Je n’avais pas besoin d’elle, mais son attitude en disait long sur notre relation. Elle me renvoyait notre histoire pourrie, et mon incapacité à l’affronter. Ils eurent un an après deux jumelles, dont il était prévu dès la grossesse que l'une d'entre elles ne survivrait pas. Cet événement leur a été bien entendu difficile à assumer. Les consommations psychoactives continuaient. En tout cas une consommation quasi permanente de joints, et d’alcool. Les deux combinés faisaient qu'ils étaient rarement dans leur état normal, et qu'ils ne se supportaient pas longtemps dans cet état dit normal. Leur humeur, leur budget, leurs relations, étaient complètement dépendantes de cette consommation. La perte de cette enfant a également été retentissante pour l’entourage, dont moi, et ce en dehors du fait qu’il lui serait encore plus difficile d’être disponible pour m’écouter. Pendant ces quatre ans, ils habitaient encore à Paris, où leurs filles sont nées, et venaient toujours les week-ends, complètement à leur guise. Il n'y eut une interruption de leurs venues que pendant la période où la grossesse de ma sœur (difficile puisqu’elle eut la tuberculose) et l'hospitalisation de ma nièce à la naissance ne leur permettaient plus de venir. Ils n'auront versé que quatre mois sur les dix-huit, de la contribution prévue pour la maison dans nos convenances orales, ce avant que ma sœur ne soit enceinte, et nous avons dû nous mêmes finir de rembourser mon père. Ils s'offusquaient pourtant lorsqu'on leur demandait une participation alimentaire, aux charges, ou aux nombreux travaux que nous avons eu à faire. Pendant ces fins de semaine, ils invitaient toujours leurs copains dans la maison pour faire la fête. Tout ce petit monde se contentait de mettre la maison sens dessus dessous sans jamais participer. Malgré son appétence pour les joints, Philippe eut alors lui aussi envie de prendre ses distances. C'est ce que nous fîmes, probablement maladroitement, car nous craignions leur colère, qui, fatalement, se manifesta par un discours violent et une injustice flagrante. Cela nous valut de rester fâchés pendant environ un an. Nous revîmes ma sœur un peu avant son compagnon, et j'avais convenu avec elle de lui ouvrir un livret d'épargne logement sur lequel j'aurai réussi à lui rendre plus que ce qu'ils avaient payé pour la maison. Non pas que je trouvais ça juste, mais c'était une façon de mettre à une distance raisonnable toute discussion sur la question financière. Le rôle de son compagnon avait été prépondérant, et ce bien qu’il se montre détaché des questions financières.C’était celui qui dépensait le plus, et voulait le moins participer. Il considérait que le fait d’avoir un pied à terre en province ne l’obligeait en rien à faire un effort, quel qu’il soit, puisqu’il l’aurait eu dans tous les cas avec ses parents. Je voulais aussi inviter ma sœur à une forme d'indépendance vis à vis de son acolyte. Cela aura fini par dissiper notre embrouille, du moins en apparence. J'appris plus tard que ces économies ne leur serviraient jamais pour investir dans l'immobilier, elles furent dépensées autrement. De toute façon, le fils ne tarda pas à bénéficier enfin de la générosité de ses parents par l'achat d'une maison. Malgré tout ça, et même pendant les périodes où nous avons été séparées, je continuais à subir son influence. Je n'assumais pas ma différence de caractère car je craignais énormément ses critiques et ses railleries. Pendant longtemps, il m'a été impossible de choisir un vêtement pour l'acheter, ou la tenue que j'allais mettre, sans me demander ce qu'elle allait en penser, ce qu'elle ferait à ma place...je m'en rendais compte et ça m'énervait, mais je n'avais aucun moyen d'arrêter le processus. Évidemment, un compliment -ils étaient rares de sa part- me flattait exagérément. Si j'avais pu, je n'aurais mis que la tenue qu'elle avait eu l'extrême obligeance de trouver "pas mal". La plupart du temps elle me trouvait mal sapée. C'était peut-être vrai, mais le cynisme avec lequel elle me le disait ne faisait rien d'autre que me laisser pleine de honte. De mon côté, je n'avais aucun sens critique sur ses goûts. En fait la question n'était pas de savoir si cela me plaisait ou pas, mais d'essayer au maximum de coller à son modèle. Je me serais habillée avec un sac si cela avait pu éviter ses sarcasmes. J'aurais fait beaucoup pour lui plaire, pour qu'enfin elle pense que j'étais quelqu'un de bien. En même temps que je n'appréciais pas du tout sa façon de vivre, j'étais aussi tolérante que possible, et surtout, je la trouvais intelligente, bien que pleine de défauts. Je ne voulais pas le montrer mais elle le savait et en jouait. J’étais encore loin d’avoir trouvé les ressources pour m’affirmer. Après qu'ils ne soient plus tributaires de nous sur le plan du logement, nos relations s’améliorèrent, même si j'avais beaucoup appréhendé de les voir s'installer près de chez nous, à dix kilomètres. Il y avait encore beaucoup de symptômes, mais globalement, nous nous en sortions, sur le mode de l'humour. Nous rigolions ensemble de conneries, souvent il fallait qu'elle soit un peu défoncée. Surtout rester en surface, ça tournait mal dès qu'on essayait de gratter le vernis. A cette époque encore, il lui arrivait quand même de se considérer comme chez elle chez nous, ou de penser qu’elle devait faire l’éducation de nos enfants. Il fallait que nous adulions ou détestions les mêmes personnes qu’eux, faute de quoi nous subissions leur foudre. Un jour elle m’aura dit que j'étais « transparente ». Cette remarque avait été faite dans un contexte tel qu'il signifiait que l'on pouvait deviner facilement mes sentiments et mes émotions. Ce n'était pas malveillant. Pas cette fois. Mais tellement inapproprié. Ce que l'on percevait de moi, c'était une sensibilité démesurée. Sensibilité majorée par le poids du secret, qui se heurtait à la difficulté implicite de l'entourage de le recevoir. On prétend souvent connaître les gens, ça nous rassure, mais nous n’utilisons pas assez nos capacités intuitives pour les connaître vraiment. Ma transparence est une fausse transparence, que je ne maîtrise pas. Elle est liée en partie à mon physique. La plupart des gens se font rapidement une idée de moi assez déterminée, et sont quelquefois déçus de s'être trompés. Comme souvent, il est plus difficile d'admettre que l'on s'est trompé, que de considérer que l'on nous trompe. J'étais donc parfois celle qui dérangeait en me montrant finalement différente de l’impression que j’avais donnée, et dont on se méfiait. Je pense être plus authentique que transparente. Même dans mon silence je l'étais. Je n’étais pas une fausse copie de moi-même. Je cachais mais ne mentais pas. Je luttais douloureusement justement pour ne pas être transparente, pour éviter que ma vérité n’émerge, pour maintenir cette mise sous scellé. Notre « Parrain » était déjà mort depuis plusieurs années, et regretté pour le personnage décalé, et altruiste qu'il était, et, alors qu’elle était enceinte de son deuxième enfant, un garçon, ce fut le tour de notre grand-mère. Son chagrin de perdre celle qui l'avait tant materné fût très démonstratif. Le mien était grand aussi, bien que moins manifeste, et j'acceptais mieux qu'elle son départ. Elle avait quatre vingt deux ans, et était arrivée au bout de son cancer généralisé. C'était une grande figure de mon enfance qui s'en allait, un personnage auprès duquel j'avais un sentiment de sécurité affective parce qu'elle s'était montrée constante, et présente dans mes moments difficiles, même si je n'ai jamais pu lui parler. Et même si sa relation avec ma sœur était plus fusionnelle, nous avions aussi appris à nous connaître et à nous aimer. Elle avait une énergie incroyable, et diffusait une aura de sûreté, de fiabilité, et de confiance, dont ses enfants n’auront malheureusement pas pu profiter. Encore pour cet événement, il ne fut pas possible d'avoir ne serait ce qu'une sorte d'harmonie entre nous. Je la plaignais. C'est vrai qu'elle a dû assumer des épreuves pendant chacune de ses grossesses. Mais à aucun moment elle ne m'aura demandé si j'avais du chagrin moi aussi. J'avais perdu tout espoir de parler à celle dont je pensais que la vie était trop dure pour recevoir mon secret. J'avais déjà parlé à Philippe, et c’est ce qui me permit quand même de prendre de la distance avec mon histoire. Ils eurent donc leur garçon, et leur relation semblait moins violente, en tout cas de l'extérieur. Entre nous, les grosses prises de bec étaient désormais souvent liées à nos enfants. Non pas les leurs, mais les nôtres. En fait, ça a toujours été extrêmement difficile pour eux d'admettre que nos enfants puissent échapper, et plus tard voulussent échapper, à l'emprise qu'ils avaient toujours eue sur nous. Nos filles leur ont au contraire très vite fait comprendre qu'elles avaient leur façon de penser, que leur tante n'était pas leur mère, qu'elles avaient leurs propres amis. Nous-mêmes, et surtout moi, à travers elles et avec leur aide, je me suis progressivement renforcée, ai gagné en confiance en moi. Je les défendais et ne supportais pas qu'il soit fait atteinte à leur intégrité , c'était ma limite. Je m'efforçais d'être juste, mais les attaques envers mes filles étaient souvent injustifiées voire injustes. Ce stade passé, et surtout après la naissance de notre dernière enfant et le départ de ma plus grande fille pour l'internat en seconde, nos deux familles se sont beaucoup moins vues. Ma mère ne s'intéressait désormais plus qu'au garçon que ma sœur avait eu, celui qu'elle aurait aimé avoir, et sur lequel elle avait jeté son dévolu. Si bien que la naissance de notre dernière fille, deux ans après, passa complètement inaperçue. Mais c'est une marge pendant laquelle nos relations, peut-être parce que plus distantes, étaient plus tranquilles. Il semblait que nous avions trouvé un équilibre. L’étendue de cette relation peut paraître lointaine du cœur de mon récit, mais tout ce que j'ai partagé avec ma sœur après le viol était teinté de la difficulté à lui parler, et je ne peux donc pas en faire l'économie. Et tout ce que j'ai vécu avec elle avant illustre la manière dont s’est développé notre fratrie dans une famille toxique. Début 2006, alors que cela me paraissait possible, je parlais du viol à ma sœur après en avoir parlé à ma mère. Pendant des semaines, j'ai essayé naïvement de lui proposer tous les moyens de communication, pensant que son mutisme était dû au choc. Je me suis efforcée, en prenant soin de ne pas la brusquer, de lui faire comprendre à quel point j'avais envie de parler avec elle. Elle m'avait donné son adresse mail sur laquelle j'écrivais et attendais en vain une réponse. J'étais en train de regretter, de culpabiliser d'avoir perturbé l'équilibre. Équilibre tant attendu pour pouvoir m'exprimer. Un jour que je l’avais encore encouragée à me répondre, elle m'avait proposé de me donner l'adresse mail de son boulot, car : "elle n'avait pas l'habitude d'ouvrir sa boîte perso". Ce que je lui avais révélé n'était pas de taille à perturber ses habitudes...Je n'écrivis pas sur la boîte du boulot. Je ne voulais pas non plus qu'elle tombe sur mes messages dans un contexte incommode. Je compris plus tard qu'elle prenait simplement le temps qu'il fallait pour se construire une douleur. Une qui lui empêcherait d’avoir à assumer la mienne. Elle manifesta sa propre tristesse, mais je n’ai senti ni tendresse, ni empathie à mon égard. Elle n’a pas su comprendre non plus que c’est probablement pour ça que j’avais préféré écourter nos rencontres, bien qu’encore plus rares depuis que nous avions déménagé. Lorsque nous venions voir la famille, nous préférions dormir chez mon oncle, tout en organisant tout de même une repas ensemble. Cela nous aura été reproché, entre autres choses, lors de notre dernière dispute. C’est vrai que je n’avais pas envie de me retrouver chez elle « comme si de rien était », comme avant, et surtout sans avoir vraiment parlé. Deux fois seulement, en dehors de notre catastrophique rencontre qui suivit, j'aurais pu parler avec elle, à chaque fois à mon initiative. La suite dira à quel point la réceptivité que j’avais cru ressentir n’a pas tenu la route. Je m’étais imaginée tellement de choses de cette révélation, mais pas ça. Notre dernière entrevue aura été pour elle, ainsi que pour son compagnon, l'occasion d’aller au-delà de ce que nous pouvions entendre. Il avait été question de la prise en charge de notre mère, et ma deuxième fille, qui était présente, évoqua la possibilité d'une maison de retraite. Pour ma part, je tentais d'expliquer que je n'étais pas dans la meilleure des positions pour prendre quelque décision que ce soit à son encontre, et que je préférerais confier ça officiellement à un tiers (c'est une question dont nous avions déjà parlé ensemble sans qu'elle ne m'ait jamais vraiment donné son avis). Comme elle s'énervait et semblait ne pas comprendre pourquoi j'avais cette opinion, je finis par lâcher le mot « viol », le mot interdit, pour expliquer le fait de ne pouvoir rien faire personnellement pour ma mère. Ce fut un déferlement de haine. On peut objectivement dire qu’ils auront été odieux. Il avait aussi été question « des psy », que je voyais trop, et de leurs médicaments, que je prenais trop. Juste un mot sur ces fameux psychotropes diabolisés. Ce que je peux en dire dans mon cas c'est que je ne vois pas bien comment j'aurais pu m'en sortir sans eux, même s'ils ne suffisent pas seuls. Également que c'est depuis que je les prends que j'ai pu, notamment, sortir de l'abrutissement induit par le manque de sommeil. Je sais maintenant que j’en aurais peut être besoin toute ma vie, un peu comme un diabétique peut avoir besoin d’insuline. Je sais aussi que ce que j’ai vécu a des conséquences purement organiques sur certaines zones du cerveau, suite au phénomène dissociatif qu’il induit. Le déséquilibre n’est souvent remédiable qu’avec un traitement plus ou moins fort, accompagné d’une thérapie. Il m’arrive de me dire que finalement chacune de nous a eu besoin de drogues...Oui, peut-être. J’ai encore quand même le contrôle sur les miennes. Mais surtout, les paroles de ce soir là étaient du genre : « il t’a violé, et alors ? », ou « tu viens foutre la merde tous les six mois », ou « t’as pas besoin de le crier sur les toits » ou « on ne ressort pas ça TRENTE ANS après !», proférés par l’un et l’autre des membres du couple. Je parle aussi au chapitre suivant de leur incapacité non reconnue à gérer cette révélation au sein de leur famille, notamment avec leurs enfants. Et la responsabilité de cette incapacité m’incombait bien entendu selon eux. Nos rapports ont donc cessé après cette réunion de famille où leurs enfants n’étaient pas présents. J’ose espérer que s’ils l’avaient été, il n’y aurait pas eu un tel déversement de haine. Mais la présence de deux des nôtres ne les ont pas arrêtés. J’ai attendu un mois les excuses que je n’aurais acceptées que sous des conditions drastiques, mais qui auraient peut-être atténué la déprime mêlée de rage dans laquelle j’étais, et qui avaient assombri la joie dans laquelle j’étais de l’attente d’un bébé par ma plus grande fille, non présente ce jour là. Je lui ai ensuite écrit pour lui signifier certaines choses. Pour la prévenir par exemple que j’allais me débarrasser de tous les cadeaux qu’elle m’avait fait depuis longtemps Je les aurais remis un jour chez ma mère. Je l'ai fait pour souligner l'importance de notre rupture qui allait jusqu'à ma résistance à voir ou à utiliser les objets offerts. Ils étaient nombreux, et beaucoup de la vie quotidienne. Elle faisait des cadeaux pour qu'on ne l'oublie pas, et c'est précisément ce que je voulais faire : l'oublier. Et j'ai voulu qu'elle le sache, ainsi que le fait que je n'envisageais aucune réconciliation. J’ai su plus tard par mon oncle qu’elle n’en envisageait aucune elle non plus et se payait le luxe de m’en vouloir… Mon aînée accepta ensuite une proposition de rencontre de la part de ma sœur pour présenter son bébé, même si elle y mit beaucoup de réserves, et pas forcément en raison de notre dispute. Mes deux autres filles l’accompagnèrent. J’ai très mal vécu ce moment auquel Philippe et moi n’avons bien sûr pas voulu participer : On pouvait donc obtenir ce que l’on souhaitait même après avoir fait preuve de la plus grande ignominie. Un sentiment d’exclusion implicite de mon vécu qui dérangeait, que l’on pouvait piétiner et tenter d’enterrer en toute impunité. Également un sentiment d’intrusion dans mon intimité de toute nouvelle grand-mère, sans s’être excusée de sa barbarie. J’ai pu en parler avec ma fille après. Je ne m’étais pas rendue compte en amont de l’effet que cela aurait sur moi. Mes trois filles n’ont aujourd’hui, à ma connaissance, plus de contact avec leurs tantes et leurs cousin et cousine. Je ne crois pas que ce ne soit qu’en raison de l’arrêt de mes relations avec eux. Ces derniers ne cherchent manifestement pas plus à en avoir avec elles. Le problème est que ma sœur ne m'a jamais accordé le droit d'être une personne à part entière. Comme si je ne pouvais exister qu'à travers elle, et que tout ce que j'avais construit lui était dû en partie. Quelqu'un qui n'est pas vraiment quelqu'un ne peut pas avoir été violé, ne peut pas dire avoir subi ce crime, ne peut pas dire comment il a souffert… Au final, qu'est-ce qui pourrait nous rapprocher elle et moi si ce n'est notre histoire commune ? Cette histoire commune ne peut avoir de sens que dans la vérité, bonne ou mauvaise. Et c'est précisément ce dont elle ne veut pas. Nous étions en 2011. Après le poulet frites dominical, elle continuait à jouer au Scrabble avec ma mère, qui ne ratait pour rien au monde ce rituel. Elles posaient toutes les deux des mots, sans jamais en avoir échangé un seul sur ce qui m'est arrivé. Dans une entente tacite sur le bien fondé de ne jamais encourager ma démarche de vérité, vérité qui était aussi trop la leur. INCESTE, c’est un scrabble. Je ne pense pas qu’elles l’aient un jour posé. Je n’arrive pas encore moi-même à le prononcer sans un trouble, même quand il n’est pas question de moi. Mais je m’astreins à le faire. Même si je dois pour ça mettre mal à l’aise les personnes de mon entourage qui savent, ou pas. C’est aussi une invitation à en faire autant, à ne pas se laisser intimider par l’ennemi. Le compagnon de ma sœur est mort en 2014 d’un cancer aux poumons. J’étais triste pour leurs enfants. Nous ne sommes pas allés aux obsèques. Ma mère est morte un an après. Nous nous sommes donc vues, mais n’avons pratiquement échangé qu’autour des démarches des obsèques. En tout cas pas du tout sur ce où nous en étions restées. Et il m’a semblé qu’elle ne tenait pas plus que moi à déterrer la hâche de guerre. Elle n’a pas non plus donné suite à ce contact, et je considère que c’est à elle que revient cette charge, si elle le désire. Pour ma part je ne donnerais suite qu’à la condition d’avoir réellement mis cartes sur table. Avoir déterré la hâche de guerre et l’avoir considérée dans toutes ses dimensions sans avoir à l’utiliser. Je veux que ses enfants sachent que ce n’est pas moi non plus qui suis à l’origine de l’arrêt des relations entre nos familles. Deux ans après la maison maternelle a été vendue. Je ne me suis pas déplacée chez la notaire mais n’ai pas refusé le petit héritage. Tout bien réfléchi, j’avais bien droit à un petit dédommagement. Dernière entrevue -à peu près identique- pour le décès de mon oncle. J’espère avoir publié ce témoignage avant la prochaine. La détente Notre présence dans le lieu dans lequel nous avions élu domicile quinze ans avant n'avait plus de sens, à plus d'un titre, en 2002. J'étais en train de mourir socialement, professionnellement, mon dernier emploi avant ma dernière grossesse n'ayant pas pu se renouveler. Mon passé m'empêchait toujours d'aller de l'avant. Il fallait que je me secoue. Philippe était partant pour changer de vie. Nous sommes venus vivre, travailler, et acheter une maison dans la ville où nous sommes encore aujourd'hui. Ce ne fut pas sans difficultés, au moins au début. Je m’attaquais à une formation pour devenir travailleuse sociale, sur deux ans. Nécessaire travail d’introspection, de levée de freins pour appartenir à un groupe, et pouvoir m’exprimer devant lui. Début de thérapie. Mon père mourut d'une crise cardiaque en 2003, et pendant deux ans les démarches et le relogement de ma mère dont nous avons dû nous occuper ont encore retardé le moment de la révélation à d’autres personnes que Philippe. Lorsque j’ai commencé à le faire, j’ai été ensuite prise par le temps pour parler à ceux qui ont compté pour moi et qui connaissaient mon père. Je ne voulais pas qu'ils en parlent entre eux avant que je ne leur en parle moi-même. Aujourd'hui encore, je n'ai parlé avec personne d'autre, si ce n’est au sein d’un groupe de paroles. Parfois, je me suis sentie à deux doigts de le faire, à un moment où des conversations s’y prêtaient. Mais ça ne se fait pas de plomber une agréable soirée entre amis avec des histoires comme ça… C’est aussi une des raisons pour laquelle j’écris ce témoignage. Mais je veux aussi m’exprimer et agir en mettant de la distance avec mon vécu. Et je n’arrive pas encore complètement à faire abstraction du miroir que me renvoient ceux qui savent. C’est sûrement pour ça que je suis travailleuse sociale d’une part, et que je ne vois pas comment je pourrais parler de ce que j’ai vécu dans cette sphère professionnelle, d’autre part. Peur de sentir chaque jour chez mes collègues, trop-ou pas assez-de légitimité de ma part pour parler de la douleur des autres. Mes filles, «celle du milieu» d'abord, puis la plus grande, ont été mes premières confidentes après leur père. La plus jeune, du fait de son âge, ne l'aura été que plus tard. Elles ont été très compréhensives toutes les trois même s'il leur est difficile de comprendre comment cette personne a pu être leur grand-père, et comment nous avons pu supporter ça. Je leur avais demandé de ne pas me traiter en victime, ni de ne me voir qu'à travers ça. Je crois qu'elles ont compris que c'est précisément parce que j'allais mieux que j'avais pu parler. Je crois ne pas avoir eu de traitement de faveur, et c'est très bien comme ça. Ce n'est pas simple de découvrir qu'il y avait un violeur dans sa famille, d'autant qu'elles n'avaient pas connaissance non plus de son côté pervers d'avant les viols. D'autres questions sur leurs vies, avec lesquelles elles pourraient faire le lien avec ça restent encore. J'espère que ce livre leur apportera des réponses. Ma mère fut la suivante, j'en ai déjà parlé. Ce fut ensuite ma sœur, comme je l'ai dit. J'aurais aimé qu'elle informe ses enfants. Elle m'expliqua, ainsi que son alter ego, qu'ils ne se sentaient pas de le faire, mais en comprenaient la nécessité. Je l'ai donc fait un jour, dans des conditions pas forcément idéales, après avoir attendu trop longtemps qu'elles le soient. C’était un devoir pour moi de le faire. Manifestement, comme le montre la dernière dispute avec eux, le message est mal passé. Ils m’auront reproché de « faire porter le chapeau » à leur fils, parce que j’avais exprimé la nécessité que ma divulgation brise la chaîne intergénérationnelle. Je ne pensais pas qu’à leur fils. Je n'avais pas pris la mesure de l'incapacité de leur famille à supporter cette histoire, qui était aussi un peu la leur. Si je l'avais prise, je ne me serais pas pour autant tue, mais j'aurais prévu le déferlement de haine qu'il a engendré. Ma sœur avait à peine réussi à m'entendre, et elle n'a jamais vraiment voulu que d'autres personnes m'entendent. Mon oncle, frère de ma mère, compte aussi beaucoup. Il a toujours fait partie de mon enfance. Pendant mon adolescence, il était venu nous voir pour des vacances dans la maison de l'enfer et avait eu des doutes sur le comportement de mon père. Je me suis toujours souvenue de ses mots un jour m'invitant à me méfier alors que ma mère affirmait « qu'il n'irait pas jusque là ».(Phrase récurrente dans la famille, utilisée pour la dernière fois à ma connaissance pour la même raison par ma sœur). Comme avec mon amie, j'avais entrevu des possibles, puisqu'il n'y avait pas que des aveugles autour de nous. Ils furent les seuls à ne pas l'être. A un moment difficile de sa vie, après mon départ, il est venu voir sa sœur. La coalition qu'elle savait former avec mon père a fait qu'ils ont réussi à le convaincre de rester. Il devint leur bouc émissaire pendant quelque temps avant qu’il ne rencontre celle avec qui il a passé le reste de sa vie. Le jour où je lui ai parlé reste très important. J'avais peur de lui faire de la peine. C'est un tonton qui n'a jamais eu d'enfants et nous étions un peu les siennes. Il s'en est voulu de n'avoir rien dit «à l'époque». Ce fut l’occasion de nous épancher mutuellement. Sa mort m’a laissé un grand vide. Il avait 86 ans, était malade, et vivait depuis plus d’un an en maison de retraite. Sa vie n’avait plus beaucoup de sens, même si d’autres conditions d’existence lui en auraient donné plus. Je regrette de ne pas avoir pu les lui offrir. Jusqu’à la fin, j’ai senti que mes trop rares visites lui étaient tout de même précieuses, à son regard qui se rallumait. J’avais beaucoup investi cette relation faute aussi d’en avoir une avec mes parents. Il y avait aussi chez lui quelque chose d’atypique, de particulièrement attachant. Il était authentique, et spontanée. Il s’en remettait aux personnes qu’il côtoyait, et était très influençable, mais n’en était pas moins clairvoyant de ce qu’il se passait. Je lui rends hommage parce qu’il fait partie des rares personnes rassurantes qui ont structuré mon enfance positivement, face à mes parents. Ensuite il y eut une cousine que j'aime beaucoup. C'est la fille du frère de ma grand-mère paternelle, la cousine germaine de mon père , mais dans les mêmes âges que nous. Elle vivait depuis toute petite avec sa tante, notre grand-mère. Nous étions restées proches même après notre départ chez notre père. Lorsqu'il la voyait en vacances, mon père aurait bien voulu avoir l'occasion d'être le premier pour elle aussi. Il le lui avait fait comprendre comme il le faisait avec nous. Elle n'avait les moyens de s'en défendre qu'en le repoussant, comme nous. Les conditions n'avaient jamais été réunies pour qu'il passe à l'acte. Cependant, lorsque je lui ai parlé, elle a tout de suite compris. Tout était dit. Nos complicités de jeunes filles nous disant que ce mec était fou. Notre emprise dans un conflit de loyauté nous interdisant de dénoncer le fils, cousin, compagnon, père. Ce fut ensuite à celui dont je dis qu'il est le fils de coeur de ma grand-mère, que je parlais. Il m'est très proche. Pour ce qui s'est passé, il est une personne particulière, puisque, comme je l'ai dit, et bien qu'il était encore un petit garçon, il était venu juste après les viols, avec ma grand mère et mon parrain, sans savoir le rôle protecteur qu'ils jouaient. Ma révélation l'a abasourdi. Il était très loin de tout ça et aurait plutôt idéalisé mon père, qu'il n'a vraiment connu que quand ce dernier était plus vieux. Il le prenait comme beaucoup pour un personnage volcanique certes, mais qui cachait sa vraie bonne nature. Nous n'en aurons pas parlé plus que ça. Ce n'est pas quelqu'un qui s'épanche facilement. Peut-être en reparlerons nous un jour. Voilà, j'estimais avoir fait le tour des personnes devant savoir, à l'exception d'une cousine avec laquelle cela m'était plus difficile d'évoquer ça. Elle est la fille de la sœur de ma mère, mais probablement aussi celle de mon père, puisqu'elle a neuf mois de moins que moi. Je laisse faire le lien avec le climat qui entourait ma naissance. C'est ce climat, et par conséquent celui de sa conception, qu'il me paraissait difficile d'éviter au moment où je lui parlerai. Finalement c'est par sa fille, elle-même au courant par ma plus grande, qu'elle l'apprit. L'histoire familiale avait fait qu'elle savait déjà que mon père pouvait être le sien, mais rien sur les conditions dans lesquelles cela avait pu se passer. Nous avons réussi à en parler un soir au téléphone. C'était important pour nous de le faire, je pense. J’ai ensuite participé à un groupe de parole pour « victimes d’inceste et de pédocriminalité ». Cela a renforcé mon aptitude à me présenter telle que j’étais, à m’autoriser à parler en présence d’inconnu(e)s, et à croiser le vécu d’autres personnes. Je me suis aussi aperçue de la difficulté à mettre un nom sur ce que j’ai vécu. Pas vraiment un inceste -au regard des représentations que nous en avons : enfants plus jeune, lien parent-enfant ; pas vraiment un viol non plus puisque l’auteur était mon père, et que c’était quand même ça qui faisait toute la différence...Il s’agit de quelque chose « entre les deux », qui n’a pas vraiment de nom… J’ai sûrement eu la chance dans tout ça de n’avoir jamais eu aucun doute sur les sentiments que je portais à mon père à ce moment là : je le détestais. Plus tard la haine s’est transformée en néant. Je savais qu'en révélant je me heurterai à l'incompréhension, voire au doute. Personne n'a envie d'admettre, et l'on cherche inconsciemment ce qui pourrait faire que ce ne soit pas arrivé. Mais j'avais décidé de faire front contre mon histoire, mon état de dépression chronique, de manque de confiance et d'estime de moi, de relations sociales difficiles. Je voulais m’affranchir de la peur que j’avais des autres, qui n’était en fait que la peur que l’on perçoive ma différence, voire mon anormalité. D’une anormalité difficile à exprimer puisqu’elle remet tout en cause. Même si j’en parle au passé, je ne peux pas encore dire en avoir fini avec ça. Par contre, j’ai évolué dans l’estime de moi. Je n’ai plus honte. Je ne cherche plus ni à être pareille, ni d’accord avec tout le monde. Ni l’inverse. Je surestime moins autrui à mes dépens, ou l’inverse parfois aussi, pour me tranquilliser. Je ne suis plus dans une logique de comparaison. Il y a la vérité de chacun, et il y a celle des faits. Je suis la première à regretter d'avoir vécu cette histoire. J'ai vainement essayé de m'en construire une autre. Mon expérience, y compris professionnelle, me montre tous les jours que ceux qui y arrivent n'arrivent souvent plus à rien d'autre. Je ne porte aucun jugement de valeur sur le fait de dire ou non la vérité. Cette dernière n'est bonne à dire que si elle est réparatrice. Dans mon cas elle l’était, et le non-dit me détruisait. Ce que j'ai vécu est tristement vrai, et sa révélation va de paire avec mon rétablissement. Je ne veux pas non plus que l’on s’en empare, que l’on déforme pour se rassurer ce que je suis la seule à pouvoir dire. Toute cette période de parole a aussi déclenché la décision de faire savoir plus largement, mais aussi pour exprimer ce que la parole ne permet pas. Cette dernière est plus appropriée aux idées qu’aux émotions. Il faut du temps pour pouvoir dire ce qui est trop douloureux. Le temps de mettre la distance nécessaire avec les faits, pour les mettre autant que possible sur le terrain des idées. J’ai toujours écrit pour m’épancher, pour m’apaiser. J’écris aujourd’hui avec beaucoup moins d’émotion. Même s’il y a une espèce d’urgence à le faire, le but est moins de s’épancher, que de témoigner. Mon récit me semble même parfois assez froid, sur un mode informatif. Je ne serai vraiment en paix avec mon passé que si je vais au bout de ma démarche. C'est ma responsabilité envers l'enfant que j'étais, envers tous ceux dont j'ai contribué à l'existence, et envers ceux qui, bien que ne me connaissant pas, pourront se reconnaître dans mon histoire. Je ne veux pas vivre avec l'identité de ce à quoi je veux tourner le dos, avec une étiquette. C'est justement cette étiquette invisible, cette empreinte, dont j'ai voulu me défaire, et à laquelle je m'identifiais bien plus avant que je ne la mette à distance. Je serais heureuse que ce témoignage, faute d'empêcher les crimes qui, malheureusement, continueront à se produire, contribue à donner du temps, et de l'espace aux victimes, participe au combat pour l'annulation du délai de prescription, et modifie le regard social sur ces calamités. J'invite chacun à avoir une antenne à l'attention, beaucoup plus nombreux qu'on aimerait le croire, des morts-vivants non déclarés, et qui ont pour beaucoup, moins de chance que je n'en aie eue.
Just Checking...
Discard Message?
You have a comment in progress, are you sure you want to discard it?
Similar community content
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate
0
Members
0
Views
0
Reactions
0
Stories read
Need to take a break?
For immediate help, visit {{resource}}
For immediate help, visit {{resource}}
Made with in Raleigh, NC
|
Read our Community Guidelines, Privacy Policy, and Terms
|
Please adhere to our Community Guidelines to help us keep Our Wave a safe space. All messages will be reviewed and identifying information removed before they are posted.
Grounding activity
Find a comfortable place to sit. Gently close your eyes and take a couple of deep breaths - in through your nose (count to 3), out through your mouth (count of 3). Now open your eyes and look around you. Name the following out loud:
5 – things you can see (you can look within the room and out of the window)
4 – things you can feel (what is in front of you that you can touch?)
3 – things you can hear
2 – things you can smell
1 – thing you like about yourself.
Take a deep breath to end.
From where you are sitting, look around for things that have a texture or are nice or interesting to look at.
Hold an object in your hand and bring your full focus to it. Look at where shadows fall on parts of it or maybe where there are shapes that form within the object. Feel how heavy or light it is in your hand and what the surface texture feels like under your fingers (This can also be done with a pet if you have one).
Take a deep breath to end.
Ask yourself the following questions and answer them out loud:
1. Where am I?
2. What day of the week is today?
3. What is today’s date?
4. What is the current month?
5. What is the current year?
6. How old am I?
7. What season is it?
Take a deep breath to end.
Put your right hand palm down on your left shoulder. Put your left hand palm down on your right shoulder. Choose a sentence that will strengthen you. For example: “I am powerful.” Say the sentence out loud first and pat your right hand on your left shoulder, then your left hand on your right shoulder.
Alternate the patting. Do ten pats altogether, five on each side, each time repeating your sentences aloud.
Take a deep breath to end.
Cross your arms in front of you and draw them towards your chest. With your right hand, hold your left upper arm. With your left hand, hold your right upper arm. Squeeze gently, and pull your arms inwards. Hold the squeeze for a little while, finding the right amount of squeeze for you in this moment. Hold the tension and release. Then squeeze for a little while again and release. Stay like that for a moment.
Take a deep breath to end.